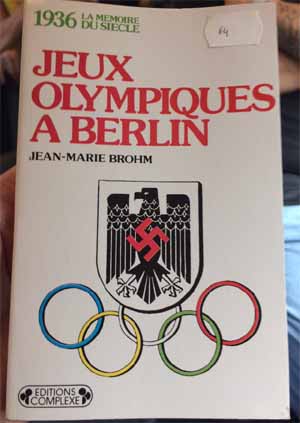Un livre revu et corrigé par Alain Accardo ; éditions Agone
Le sous-titre de l’ouvrage – « Du journalisme considéré comme une fraction emblématique de la nouvelle petite bourgeoisie intellectuelle » – en définit la problématique qui prolonge un précédent travail de recherche de l’auteur portant sur les classes moyennes.
En une centaine de pages (en petit format), Alain Accardo propose une analyse très dense qu’il est difficile de résumer sans la mutiler. On n’en retiendra ici que les aspects les plus saillants, en soulignant la question qui traverse cet ouvrage : dans quelle mesure les journalistes sont-ils individuellement et collectivement responsables de l’état de l’information et des médias ? Dit autrement : le déficit de pluralité, la course aux scoops et la pêche aux buzzs sont-ils imputables à des journalistes qui cavaleraient derrière les desiderata des chefferies, servant diligemment les intérêts et les volontés des puissants au sein du champ, ou bien aux structures économiques, juridiques, sociales et politiques de la production de l’information ? La question interpelle directement les militants politiques eux-mêmes, parfois prompts d’un côté à dénoncer certains comportements dont les journalistes seraient responsables, ou au contraire à les présenter comme surdéterminés par l’organisation de la profession et, littéralement, irresponsables de l’état de la presse.
La bonne focale
Cet essai de « socioanalyse du journalisme » s’ouvre par un préalable d’une quarantaine de pages qui, l’auteur le souligne lui-même, n’est pas « une simple digression théorique » (p. 42), mais un ensemble de considérations indispensables à une bonne compréhension de la suite de sa démonstration. En résumé, l’auteur appelle à sortir des fausses oppositions entre une perspective qui met l’accent sur les déterminations structurelles de l’action, et une autre qui exalte l’indépendance et l’autonomie absolues des individus. Ce qui revient à dire que les contraintes objectives qui pèsent sur les journalistes (produire dans l’urgence un article ou un reportage correspondant à la commande du rédacteur en chef, elle-même dictée par le souci de l’audimat et de la rentabilité du média) ne sont pas subjectivement vécues comme telles par les intéressés, mais plutôt comme les ferments d’une saine émulation professionnelle (la recherche acharnée et fiévreuse de l’information, ou mieux, du scoop, c’est-à-dire de l’information obtenue « en exclusivité », avant les concurrents).
À l’aune de cette démarche, l’auteur évoque les pratiques des journalistes, à commencer par « la perpétuelle urgence dans laquelle [ils] travaillent ». Celle-ci s’explique par la contrainte objective d’un métier dont l’un des rôles est de traiter de l’ « actualité » quotidienne, formatée par l’emprise quasi hégémonique de l’audiovisuel et de l’information « en continu », mise à jour heure par heure, quand elle n’est pas « en live ». Or l’urgence se traduit par des manquements systématiques aux méthodes que la profession a historiquement constituées pour travailler à la fois vite et bien. Faut-il pour autant considérer les journalistes comme de simples marionnettes, mues par l’urgence imposée par l’exigence d’audimat des actionnaires industriels des médias ? L’existence de (rares) signes de mécontentement voire de contestation au sein de la profession, des « ferments de résistance interne » [3] qu’il ne faut certes pas « minimiser », sans non plus en « surestimer » la portée (p. 62), conduisent l’auteur à se demander « pourquoi dans leur grande masse les journalistes ne s’insurgent pas davantage contre l’adultération de leur travail » (p. 47).
Pour le comprendre, il faut sortir des limites de l’analyse macrosociologique. Les effets des contraintes économiques se doublent de ceux d’une concurrence spécifique pour des enjeux symboliques et non pas économiques : les journalistes, issus de la « petite bourgeoisie » dans laquelle les capitaux économiques sont suffisants pour être moins valorisés que le prestige symbolique, ne sont pas tant disposés à la recherche de rémunérations matérielles qu’à celle de gratifications symboliques et sociales. Ainsi, sont-ils prompts à dénoncer les milieux d’affaires dont ils sont les « rivaux dominés » (p. 91), riches de capitaux économiques mais souvent moins pourvus en capitaux culturels valorisés par les journalistes. Aussi, cette position ambiguë dans les hiérarchies sociales, à la fois dominants culturellement, prompts à produire des images mélioratives d’eux-mêmes (défenseurs de la démocratie, amoureux de la liberté d’expression), mais dominés économiquement et méprisés par les élites politico-financières, les dispose à une attitude tout aussi ambiguë quant à ces élites : s’il est de bon ton de dénoncer les « affaires » du monde politico-économique, il ne s’agit jamais que de jeter l’opprobre sur telle « brebis galeuse » ou tel « patron voyou ». Or ce mode de dénonciation ratifie implicitement la domination collective des bourgeoisies politico-économiques dont il ne faut souligner que les abus – traités comme de simples et exceptionnelles déviances individuelles –, laissant leur position structurelle de domination immaculée – voire même légitimée par la fascination que la vie mondaine des élites opère sur les journalistes.
C’est la même ambivalence que traduit le « caractère spontanément populiste, voire misérabiliste, du rapport avec les classes populaires » (p. 97), réduites dans les reportages à une collection de cas singuliers, tandis que les collectifs sont abordés avec réticence et que les représentants syndicaux sont maltraités : « Bref, tout se passe comme si le “peuple” n’était intéressant pour les médias qu’autant qu’il est inoffensif, désorganisé, souffrant, pitoyable, mûr pour les Restos du cœur, l’intervention caritative et le miracle du loto. » (p. 100)
Pis, cette position dans les processus de production les conduit à céder à des conditions de travail précaires pour accéder aux situations professionnelles les plus enviées et valorisées (au moins dans les milieux sociaux où ils évoluent). Dans un champ où la compétition pour un poste stable, et a fortiori d’influence, est féroce, l’impression (plus ou moins fondée) de faire partie d’un collectif restreint, d’une élite difficile à pénétrer, nourrit des représentations de soi particulièrement gratifiantes. Lesquelles tiennent très largement du fantasme étant donnée la misère de position de la plupart des journalistes, pris entre le marteau des chefferies éditoriales et l’enclume de leurs rêves de liberté d’informer auxquels ils ne peuvent renoncer sans se renier. Aussi les journalistes n’ont-ils généralement pas intérêt à contester l’injonction à la rapidité, sous peine de passer pour de mauvais professionnels. Les chefs de rédaction, devenus de véritables managers, peuvent ainsi affirmer qu’être un bon journaliste, c’est faire un sujet avant son concurrent plutôt que de le faire bien, faisant d’une règle économique (la concurrence et l’impératif de la profitabilité) une règle journalistique sans rencontrer d’opposition conséquente. Avoir un scoop avant la concurrence tend à devenir une règle journalistique aussi importante, voire plus, que la vérification dudit scoop.
Pluralisme et uniformité sociale
Partant du constat que la pluralité d’opinions des journalistes, mise en scène à grands renforts de débats contradictoires, ne peut occulter le fort consensus au sein de la profession à propos, notamment, de ce que doivent être les médias, l’auteur explique la faiblesse des contestations internes de l’ordre médiatique établi par un recrutement social très homogène.
Il émet en effet « l’hypothèse d’un habitus de classe », c’est-à-dire d’un ensemble de dispositions sociales communes liées à une même classe de conditions objectives d’existence dont chaque habitus personnel (n’) est (qu’)une variante individuelle. Si les expériences individuelles des journalistes ne sont certes pas strictement identiques, leurs comportements sont comparables.
Alain Accardo ne réfute pas les liens individuels entre certains journalistes et personnalités du monde des affaires et/ou politique. Au contraire, ceci confirme selon lui « l’hypothèse de l’habitus de classe » : les mondes politiques, médiatiques et les milieux d’affaires partagent ainsi des références, des comportements, des codes communs, les foyers sociaux de recrutement de ces différents domaines étant perméables voire quasi similaires.
Certes, l’on pourrait souligner des cas de « transfuges » sociaux, issus des classes populaires et parvenant à intégrer la profession, pour montrer l’ouverture sociale des milieux médiatiques. Le sociologue rappelle cependant qu’en plus d’être numériquement marginaux, les transfuges ne parviennent à pénétrer un champ auquel ils n’étaient pas a priori disposés qu’au prix d’un sur-effort d’abandon des codes des classes populaires qui pouvaient être les leurs et d’adhésion redoublée aux codes de la petite bourgeoisie intellectuelle à laquelle ils doivent donner des gages d’appartenance. Un renoncement pouvant provoquer une divergence entre l’habitus primaire de l’individu et les codes auxquels il est sommé d’adhérer dans les salles de rédaction, et être à l’origine de situations d’inconfort, voire de souffrance, prédisposant les transfuges à la critique de leur milieu.
D’autres médias sont-ils possibles ?
Dès lors, quelle liberté peut-on reconnaître aux journalistes ? Quand ils revendiquent leur liberté, les journalistes, en général, manifestent en réalité la concordance des structures organisant la profession et leurs propres aspirations subjectives, aspirations résultant largement de l’état desdites structures. Bref, « ils font librement ce qu’ils sont socialement programmés à faire » (p. 108) Celles et ceux qui se disent les plus libres sont bien souvent les journalistes qui, précisément, sont en position de domination, et peuvent justement influer sur l’organisation de la profession. Or cette influence se résume bien souvent à verrouiller l’ordre social organisant la profession.
« Quelle thérapie pour les médias dominants ? » : telle est la question à laquelle Alain Accardo apporte une double réponse à la fin de son ouvrage.
« Les grands médias », dit-il, « sont partie intégrante des moyens de défense et de reproduction de l’ordre capitaliste et on ne saurait donc les changer en profondeur sans s’attaquer à ce qui est la racine de leur fonctionnement : la logique de marché et la recherche de la rentabilité et du profit maximum ». La « libération des médias » supposerait donc de « casser les reins aux empires de presse ». Et cela de deux façons : par l’expropriation de groupes industriels et financiers et par la création d’un grand service public de l’information.
Mais cela ne suffirait pas. Il conviendrait encore de « changer le type de journalisme et donc de journalistes que les structures actuelles ont façonné », en modifiant leur recrutement et en créant « un réseau d’écoles du journalisme » ajusté aux besoins d’un service public de l’information, à la différence des médiocres écoles actuelles.
Ce n’est qu’au prix de ce double changement conjointement mené que le journalisme, « métier de la production symbolique » (p. 123) et donc puissant générateur d’affects, cesserait de contribuer à produire des sujets « dévoués corps et âmes » à l’ordre capitaliste établi (p. 125).
acrimed.org