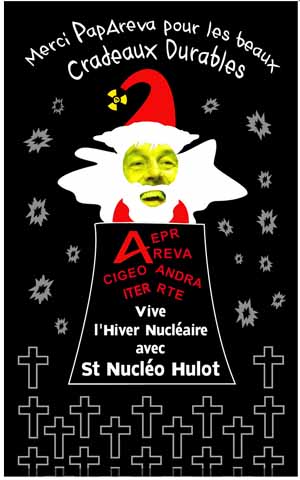Anthologie d’Andrea Dworkin
Préface de Christine Delphy
Quand la jeune Andrea Dworkin publie son premier livre de théorie féministe, Woman Hating, en 1974, les « anciennes » – Kate Millett, Audre Lorde, Phyllis Chesler – saluent son ton « abrasif, extrême », sa « rapidité », sa « pureté », et une capacité unique à exprimer et à susciter la colère, toutes les colères. Colère de la victime, mais aussi colère de la femme-qui-ne-se-croyait-pas-victime-et-qui-se-reconnaît-pourtant-dans-la-photo-du-meurtre.
Car c’est de cela qu’il s’agit dans l’œuvre de Dworkin : du meurtre, de l’anéantissement des femmes dans la sexualité masculine.
Cette colère en provoque une autre : les hommes, toujours aux postes de commande des maisons d’édition, et parfois des voitures qui emmènent les conférencières féministes (c’est ainsi que Dworkin gagne sa vie), trouvent que trop c’est trop. Our Blood, son deuxième livre théorique, raconte dans l’introduction une partie de cet exil intérieur, de façon parfois comique. Les femmes de la maison d’édition, intéressées par le livre – recueil de conférences –, lui demandent un exposé : pendant qu’Andrea parle de « la réalité matérielle de l’appropriation du corps et du travail des femmes », des cadres en costume et cravate prennent des notes sans dire un mot. C’est l’arrêt du livre chez cet éditeur : un chef de département jette le manuscrit à la tête de la femme chargée de la collection. « Je n’y ai pas reconnu la tendresse masculine », dit-il. « Je ne sais pas, commente sobrement Andrea, s’il l’a dit avant ou après avoir lancé le livre à travers la pièce. »
Le viol1 toujours présent comme réalité ou fantasme dans la sexualité masculine ou plutôt patriarcale, car c’est l’idéal-type de ce que les gynécologues appellent « rapports », et qui hante tous les cerveaux, des femmes comme des hommes ; tel est le thème que Dworkin explore, expose, la thèse qu’elle développe tout au long de son œuvre.
Le viol est le modèle de la pornographie, et la pornographie révèle ce qu’est la sexualité masculine : à la fois effet et garante de la domination des hommes. « L’érotisme, c’est quand on force, lorsqu’il n’y a pas de consentement », disait un homme interviewé par Paris-Hebdo en 1980 (voir la couverture du n° 8 de Questions féministes, mai 1980)2.
De Woman Hating, où elle met en place ses thèmes, à Intercourse – « le livre le plus choquant jamais écrit par une féministe » (Germaine Greer) – en passant par Pornography : Men Possessing Women, Dworkin n’a de cesse de mettre en évidence la réalité de ce qu’on appelle les rapports sexuels : il n’y a pas de « rapports » au sens où « rapport » implique une réciprocité et une mutualité. Ce que les hommes demandent aux femmes, c’est de consentir à leur propre humiliation, à leur propre anéantissement en tant que personnes ; non seulement d’y consentir, mais de le demander, et même d’y prendre plaisir, pour être « une vraie femme ». Car « être une femme » c’est être baisée par un homme ; mais être « baisée » (ou « baisé »), comme le langage familier ne l’ignore pas – et comme le langage universitaire l’ignore dès qu’il est question… de sexualité ! –, n’est pas une expression qui décrit mais une expression qui signifie.
Quand un homme dit « j’ai été baisé », ou « il me l’a mis bien profond », ou encore « j’ai été possédé », parlant d’un autre homme, ce qu’il veut dire, c’est qu’il a perdu dans la transaction ; pas perdu de façon loyale, mais grâce au mensonge ; l’autre a été plus habile que lui en tromperie, et l’a dominé. Et ce qu’il utilise comme métaphore pour signifier cela, c’est ce qu’il fait à sa femme, et dont il se vante. Quel que soit le sens que la femme donne à cet acte, quoi qu’elle veuille penser, puisqu’il a mis son pénis à lui dans son vagin à elle, et que ça s’appelle « baiser », cela veut dire qu’il a gagné, et qu’elle a perdu, qu’elle a été vaincue dans une compétition qui n’a pas pour enjeux des vaches ou des voitures, mais la hiérarchie des sexes.
Il faut avoir vu Dworkin debout derrière un pupitre commencer ses interventions sans introduction par la description la plus exacte qui soit d’une image pornographique, description qui suffit à en faire comprendre l’horreur. Cette capacité à dévoiler la lettre cachée, dans des conférences qui lui valent le nom de « la féministe éloquente » et dans son œuvre considérable – treize livres, voir la bibliographie en fin d’ouvrage –, suscite l’admiration ou la haine, ferventes dans les deux cas.
Quand Andrea Dworkin est morte dans son sommeil le 9 avril 2005, à cinquante-neuf ans, nous avons perdu une immense féministe, l’une des plus importantes de notre époque. L’une des plus complètes aussi : militante et théoricienne, autrice d’essais et de romans, mais aussi corédactrice avec Catharine A. MacKinnon d’une célèbre proposition de loi contre la pornographie. Et la plus brave d’entre nous.
On voudrait pouvoir donner à lire tout le travail d’Andrea Dworkin. Or si elle a été traduite en néerlandais, suédois, norvégien, hébreu, russe, espagnol, japonais et coréen, en 2017, seuls ont été traduits en français, et publiés au Québec, Pouvoir et violence sexiste et Les femmes de droite.
Ce que nous publions aujourd’hui est un recueil de textes courts, traduits par Tradfem, une collective de traduction. La première partie du recueil contient des textes autobiographiques et une fiction (« Premier amour ») ; la deuxième partie, des analyses d’un point de vue antinaturaliste et antiessentialiste ; la troisième partie, une sélection d’allocutions.
En dépit de leur taille modeste, on trouve dans chacun de ces textes la beauté du style, tant littéraire que politique, de Dworkin : elliptique, cru, d’une force redoutable car fondé sur une intégrité morale qui ne respecte aucune vache sacrée, ne reconnaît aucun intérêt supérieur à celui de l’humain.
Dworkin dépasse les limites de la décence ; elle juge notre système selon un seul critère, son adéquation ou non à la dignité des gens. Et pour elle, le système sexuel du patriarcat est incompatible avec la liberté et la dignité des femmes.
La sélection que présente ce recueil met à l’honneur les thèmes de Dworkin : la dénonciation du viol, de l’inceste, de la pornographie, de la prostitution. Ces quatre violences sont liées à ses yeux : la prostitution est un viol répété – on change de violeur, pas de femme ; l’inceste est le premier viol, celui qui conduit souvent à la prostitution ; la pornographie est le modèle de sexualité proposé aux jeunes, surtout aux jeunes hommes, qui leur apprend, s’ils ne le savaient pas déjà, à mépriser, à utiliser et à détruire psychologiquement les femmes, à les rendre incapables de juger les violences exercées contre elles comme « vraiment graves », puisque le reste de la société ne le pense pas, ne les défend pas.
Selon une étude du Conseil supérieur de l’audiovisuel3 de 2004, « 80% des garçons entre quatorze et dix-huit ans et 45% des filles du même âge déclarent avoir vu au moins une fois un film X durant l’année passée […] les garçons expriment une opinion plutôt positive à l’égard de la pornographie (54% disent que cela les amuse et les distrait, 34% que cela leur plaît et 16% que cela leur est utile), alors que les filles notifient leur aversion pour ce type d’images (56% disent que cela les dégoûte, 28% que cela les met mal à l’aise, 26% que cela les choque) ». Le combat commence tôt, et mal. Dans la pornographie il est explicité : la sexualité, c’est l’humiliation des femmes (et des hommes traités comme des femmes). C’est ainsi qu’on fait advenir une catégorie d’êtres humains qui sont très tôt définis comme humiliables et humiliés.
C’est ainsi que la définition de « l’acte sexuel », auquel les femmes ne peuvent pas échapper, confirme leur statut inférieur, qui justifie les rôles de servantes, d’assistantes, d’auxiliaires, de secrétaires, de caissières et autres postes subalternes auxquels elles sont « prédisposées » ; et réciproquement, ces rôles, auxquels on les prépare depuis la plus tendre enfance, corroborent et justifient la définition de « l’acte sexuel ».
En France en 2017, Marlène Schiappa, interviewée par une journaliste de Libération, parle de son livre Où sont les violeurs ; elle révèle que selon une note de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, « le viol est l’un des crimes les moins dénoncés à la police et à la gendarmerie ». Seules 13% des personnes se déclarant victimes ont déposé plainte. Pourquoi si peu ? Parce que les premières questions qu’on leur pose sont : « Qu’est-ce que tu faisais dans cet endroit ? », « Comment étais-tu habillée ? », « Est-ce que tu le connaissais ? » et… « Est-ce que tu as dit non de façon explicite ? ». Annie Ferrand, interviewée par une journaliste du Figaro Madame, confirme : « L’attitude de la société envers les personnes violées est profondément injuste à plusieurs niveaux. De très nombreuses femmes m’expliquent qu’elles ont été très mal reçues par les services de police. Il ne faut évidemment pas généraliser mais il est vrai que je ne compte plus les témoignages de refus de plainte, de pressions pour modifier ses propos ou les retirer, de sarcasmes et de moqueries. Faire valoir ses droits quand on a été victime de viol est un véritable combat de Sisyphe4. »
Et après cette épreuve – et les innombrables examens et interrogatoires qui suivent – seul un violeur sur 16 est finalement condamné. Marlène Schiappa rappelle que comme pour le harcèlement sexuel, « on a du mal à utiliser le mot de viol », et que « dans le traitement médiatique on utilise souvent des mots détournés, des euphémismes… non seulement des hommes ont assimilé que le corps des femmes était un bien public et qu’ils pouvaient en disposer comme bon leur semble, mais en plus les femmes considèrent parfois que c’est de leur faute… Il y a une forme de fatalisme ». Elle dit que « pour beaucoup (d’hommes) ce n’est pas quelque chose de condamnable… à un moment il faut dire aux hommes que c’est interdit. 71% des viols sont prémédités. L’immense majorité des viols est donc perpétrée par des hommes qui ont consciemment forcé une femme5 ».
Et le même jour, un prêtre pédophile reconnaissait à la télévision, parlant de dos et avec honte, que pendant des années, il ne s’était jamais demandé ce que les attouchements qu’il imposait à de jeunes garçons avaient comme conséquences destructrices pour ces enfants, il n’avait « jamais imaginé les ruines qu’il semait ».
En 1982, à New York, Adrienne Rich m’avait recommandé de rencontrer Dworkin, et je l’ai rencontrée. Je l’ai revue en Angleterre et à Paris. Nous avons correspondu, avec de longs intervalles de silence. J’ai essayé, sans succès, de faire publier en français Pornography, que Martin Dufresne avait commencé à traduire. En 1993, nous avons traduit et publié dans Nouvelles Questions féministes (n° 2), un de ses seuls articles libre de droits, « Israël : à qui appartient ce pays ?6 », pour qu’elle commence à être connue en France.
Dworkin possède à la fois le tempérament de la polémiste et la rigueur de la théoricienne. Son écriture, extrêmement travaillée, est unique. On peut, on doit la considérer comme l’une des grandes stylistes de la langue anglaise de ces cinquante dernières années. Sa volonté de ne jamais euphémiser la réalité lui vaut une réputation de mauvais goût et d’exagération. Comme on le sait, quand une féministe est accusée d’exagérer, c’est qu’elle est sur la bonne voie : les féministes du monde entier l’invitent à parler. En dépit des critiques, des boycotts – en particulier par toute l’édition étatsunienne, elle devra publier en Angleterre –, elle continue, année après année, à décortiquer l’abjection que constitue l’érotisation de la domination et de la soumission ; elle montre comment la consubstantialité entre sadisme et désir pour les uns, masochisme et désir pour les autres, transforme les scènes d’humiliation en scénarios « amoureux ».
Dworkin n’était pas une femme gaie : comment l’être quand on est habitée par la tristesse de constater que toute notre culture – y compris et peut-être surtout le domaine dit « affectif » – est fondamentalement pervertie7 ? Et qu’on s’est donné pour mission de le crier, d’ameuter les femmes, et les hommes de bonne volonté, pour la changer ? On lui faisait une réputation de dragon – réputation qui, à l’inverse de ses écrits, a traversé l’Atlantique ; j’ai découvert une femme douce, un être dont la bonté profonde transparaissait dans le sourire. Si elle se plongeait dans les eaux glauques de la pornographie, elle qui aimait par-dessus tout la beauté, ce n’était pas par goût, mais par devoir moral ; ce n’est pas seulement contre l’exploitation des femmes, mais contre toute atteinte à la dignité humaine qu’elle se sentait obligée de s’élever ; la compassion – au sens étymologique du terme – pour les êtres était au principe de sa vocation, et non la haine, comme le disaient ses détracteurs.
Petite fille juive, elle avait cassé sa tirelire tous les mois pour planter des arbres en Israël ; elle avait imaginé ce pays comme l’exact contraire du New Jersey : comme « l pays des arbres et de l’égalité entre les sexes ». Bouleversée quand elle découvre à quarante ans la façon dont les femmes et les Arabes y sont traités, elle tentera de concilier sa tendresse pour Israël et sa déception en explorant le paradoxe de l’opprimé devenu oppresseur dans Scapegoat. Mais quand son pays réel, les États-Unis, occupe, détruit, torture et tue en Irak une fois de plus8, c’est une fois de trop pour Dworkin. Usée par les combats et l’hostilité des médias, elle ne pense pas plus qu’avant à se protéger, mais repart à la bataille, cette fois contre le nationalisme étatsunien. En commençant Writing America, elle voulait montrer comment chez les écrivain·es étatsunien·nes le genre est totalement lié à l’identité nationale ; comment l’idéologie à l’origine de la guerre contre l’Irak participe de la même logique de domination et de soumission que le genre. Writing America ne sera jamais terminé.
Et, contrairement aux avis des critiques – dont certaines féministes – qui la trouvaient trop pessimiste, qui croyaient ou voulaient croire que « les choses allaient s’arranger d’elles-mêmes », les choses ne se sont pas arrangées. En 1995, Dworkin exhortait une fois de plus les femmes à résister, à ne pas céder (voir le dernier texte du recueil). Les jeunes féministes en France et ailleurs, qui ont enfin pris le relais de notre génération, se rebellent avec une force renouvelée contre le harcèlement, le viol, le mépris, les coups conjugaux : contre la barrière de la « sphère privée » qui, censée protéger « l’intimité du foyer », garantit en réalité l’impunité des bourreaux en déniant aux femmes – et aux enfants – les protections du droit commun9 ; elles appuient leurs aînées dont les manifestations font libérer une « meurtrière de mari ». Elles s’insurgent pour recouvrer la dignité d’êtres humains que le patriarcat leur a déniée : car, comme le dit toute l’œuvre de Dworkin, pour défendre sa dignité, il faut d’abord en avoir une.
entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/11/16/preface-de-christine-delphy-a-lanthologie-dandrea-dworkin-souvenez-vous-resistez-ne-cedez-pas/
******* **************
Présentation détaillée du livre :
entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/2017/10/30/andrea-dworkin-une-anthologie-a-paraitre-en-co-edition-syllepse-et-remue-menage/