tract de crise Gallimard
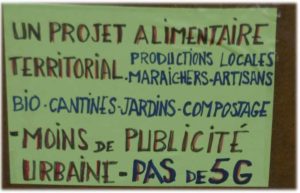
Au moment où pour vaincre le coronavirus on nous incite chaque jour davantage à accepter un contrôle de la population par la «_solution numérique_» – qu’elle s’appelle Stop_Covid actuellement ou porte un autre nom demain –, il faut se pencher sur les arguments de la petite minorité de citoyens qui s’y refusent absolument et sera sans doute incomprise, malgré le débat parlementaire annoncé. Peut-être même se fera-t-elle honnir par ses prises de position inflexibles sur le maintien à tout prix des libertés publiques, au détriment, si nécessaire, d’un surcroît d’efficacité sanitaire. Prenons la peine de les écouter car on entendra peu ces voix qui récusent l’esprit du temps et la peur le caractérisant – ce mal profond qui nous taraude depuis longtemps mais que la pandémie de Covid-19 a extraordinairement accéléré. J’espère qu’on pardonnera à cette fraction de citoyens à laquelle j’appartiens son amour immodéré pour «_la liberté avant toute chose_», puisque tout part de là et que tout y revient.
********** **********
Le projet Stop Covid de traçage numérique de nos vies est difficilement attaquable sur le fond puisque conçu pour notre bien commun. Le « tracking » – son nom anglo-saxon dit bien les choses – a donc de fortes chances de faire partie de notre avenir et d’étendre définitivement son emprise sur nous. Il joue sur l’érosion de notre volonté collective de
vivre libre et s’appuie sur les possibilités infinies fournies par les nouvelles technologies.
Nous devons toutefois contester l’idée même d’un pas supplémentaire vers ce qui deviendrait le commencement d’une surveillance de masse dont le caractère totalitaire ne peut échapper qu’aux étourdis. Les voix qui prétendent le contraire et parlent de fantasme sont invalidées par le seul fait qu’elles ne démontrent en rien l’inverse, jouant seulement sur deux de nos culpabilités supposées : n’être pas assez « modernes » et ne pas vouloir tout faire pour sauver ses semblables.
Quoi qu’il en soit, nous sommes en droit de considérer qu’un principe intellectuel et spirituel surplombe tous les autres – et même leur donne sens. Ce principe n’appartient ni au passé, ni au présent, ni à l’avenir, mais à ces trois temps. Il stipule qu’il n’est rien qui se puisse placer au-dessus de la liberté en général et des libertés individuelles en particulier, pas même la sécurité – et encore moins la servitude, cela va de soi. Par liberté, il faut entendre a minima : la capacité à agir et penser par soi-même.
Ainsi, la problématique soulevée par le Covid-19 n’est pas seulement sanitaire et économique. Elle pose avec brutalité l’éternelle question métaphysique du sens et de la valeur de l’existence, interrogation que nous avions mise de côté, semble-t-il. Pourquoi vivre si l’on n’est pas d’abord libre, telle est la question face au projet gouvernemental.
Les générations qui nous ont précédées ont eu bien souvent à se battre pour le principe de liberté, acceptant de mettre entre parenthèses leur sécurité. Pourquoi renoncerions-nous d’office à maintenir cet esprit qui n’autorise aucune concession de fond puisqu’on ne peut pas être libre à moitié ou au trois-quarts. On est libre ou on ne l’est pas. Et c’est seulement quand on l’est véritablement qu’on vit en régime démocratique. Cela n’empêche nullement que les citoyens de ces régimes consentent à restreindre temporairement leur liberté quand l’intérêt général est en jeu – comme ils le font actuellement avec le confinement – mais ne signifie en aucun cas qu’ils acceptent d’office un contrôle supplémentaire par des voies intrusives qui plongent au coeur même de leurs vies privées et de leur intimité, ce qui est tout autre chose. Dans l’hypothèse où cela adviendrait, nous serions face à un bouleversement périlleux de l’idée même de démocratie, remettant en cause nos valeurs fondamentales. Si la modernité et ses progrès technologiques supposent que des gens dont nous ne savons rien puissent tout connaître de nous, il faut répudier ce contre-progrès, ne serait-ce que parce qu’il porte atteinte à la dignité humaine.
Et accepter de payer le prix de cette répudiation.
Ce positionnement à la radicalité assumée n’est pas nouveau –quoique nous le négligions depuis au moins un siècle. Il appartient à notre histoire et pourrait redevenir nôtre puisqu’il nous a construits tels que nous le sommes encore. Son origine remonte aux écoles stoïciennes de l’Antiquité où vivre libre était le substrat fondamental de la vie bonne – et la crainte de la mort le début de l’esclavage.
L’un des symboles les plus frappants de cette conception de l’existence reste Caton d’Utique. Lorsque la démocratie disparaît après la victoire de César sur Pompée, il se suicide, jugeant que vivre en dictature revient à ne pas vivre. De nos jours, il n’est naturellement plus besoin de se montrer aussi absolu dans ses choix, mais la leçon vaut
toujours. Elle enseigne que si nous voulons continuer à placer la liberté au-dessus de tout, nous devons interroger trois de nos concepts que tout relie – la sécurité, le risque, la mort – et réviser notre regard sur eux compte tenu de leur mutation.
La mort, tout d’abord : elle ne nous est plus familière.
L’effroi qu’elle inspire désormais nous pousse à accepter sans peine ce que nous aurions jadis refusé sans crainte.
Soixante-dix ans de paix et de prospérité nous ont éloignés, nous autres Occidentaux, du tragique de la vie et de sa finitude – les réservant aux autres peuples dont nous contemplons de loin les épreuves incessantes. Il ne s’agit pas, bien sûr, de remettre en cause les progrès inestimables apportés par la paix, ce serait pour le moins ridicule, mais de constater qu’ils ont aussi conduit à faire de la mort un tabou et que cela a des conséquences sur le prix que nous sommes prêts à payer pour demeurer libre.
Le risque ensuite : quoi qu’on en pense, il est consubstantiel à la vie. Il appartient à notre humble condition de mortels. Jusqu’à il y a peu, on admirait donc les hommes capables de prendre les risques nécessaires à l’accomplissement de grandes choses. Il fallait en passer par là pour progresser, inventer, découvrir. Tout cela est terminé. Dans notre époque post-héroïque – où l’on théorise depuis trente ans la fin du courage – le risque a changé de statut. Devenu répréhensible et condamnable, il est ce qu’il faut éviter quelles que soient les circonstances. Le temps présent nous enjoint de tout faire pour vivre sans risque. Dans le domaine militaire, ce rejet a conduit au concept de « guerre zéro mort » dont on constate aujourd’hui l’impossibilité manifeste – sauf à accepter de perdre toutes les guerres, ce qui est en train de nous arriver.
La sécurité, enfin : si elle a toujours été l’une des quêtes essentielles de l’humanité, elle n’avait encore jamais autant pris le pas sur tout le reste. L’une des équations de la vie nous enseigne pourtant qu’il existe un rapport constant entre sécurité et liberté – un rapport en forme de vase communicant : augmenter l’une, c’est diminuer l’autre dans la même proportion. Longtemps, nous avons su doser intelligemment ce rapport pour nous assurer une vie à peu près sûre et à peu près libre, dans un monde imparfait, fugace et volatil. Depuis peu, nous avons rompu cette sorte de pacte pour faire de la sécurité le nouvel étalon de nos sociétés, et de la liberté un accessoire optionnel.
Dans le combat contre le coronavirus, les « personnalités » qui nous engagent à céder une part supplémentaire de nos libertés via notre « traçage numérique » sont largement majoritaires. On les entend beaucoup mais il ne faut pas se laisser endormir par les paroles lénifiantes à propos de soi-disant garde-fous aux noms nouveaux et pittoresques, comme « données anonymisées » ou « agrégées », « consentement éclairé » ou « exception numérique ». Il s’agit d’une novlangue. Rien de ce qui se trouve sur un téléphone ou un ordinateur n’est réellement et absolument anonyme.
Ceux qui transigent sur la restriction des libertés, au prétexte que cette restriction ne serait que provisoire, méconnaissent le fonctionnement de la nature humaine et ce qui mène les sociétés comme ce qui conduit les pouvoirs en place. Ils refusent de voir ou de comprendre qu’en matière de contrôle il n’est pas de retour en arrière quand celui-ci est le fait d’un progrès technologique. La surveillance numérique serait si efficace qu’on y reviendrait à la première occasion car il y aura toujours un « virus » quelconque pour nous menacer. Il portera même toutes sortes de noms –à commencer par celui de terrorisme– permettant de justifier la poursuite du contrôle et son perfectionnement, jusqu’à ce qu’il devienne la norme.
Accepter cela aujourd’hui, ce serait mettre le doigt dans un engrenage irréversible, s’engager sur une pente fatale, accepter la rupture d’une digue. Le contrôle numérique du peuple franchirait la frontière du contrôle acceptable – d’autant qu’il se surajouterait à la société de surveillance généralisée dans laquelle nous sommes déjà entrés. La sagesse nous engage à ne pas monter une marche de plus sur l’escalier du totalitarisme menaçant les sociétés modernes – ce totalitarisme qui ne tue pas mais empêche de vivre.
Moins d’un mois après la congélation volontaire du pays pour cause de pandémie, nous savons donc quel défi existentiel nous pose l’animalcule qui en est à l’origine. Sans rien nier des souffrances qu’il nous inflige et de la nécessité absolue que nous avons de le combattre tous ensemble, ce n’est pas tant l’humanité qu’il aurait risqué de faire disparaître que dès à présent nombre des libertés communes dont nous disposons encore et font de chacun de nous des hommes véritables et non des hommes domestiques. C’est ce qu’il faut défendre maintenant car les temps, au-delà de la seule crise sanitaire que nous traversons, n’ont jamais été aussi orwelliens.
Dans son Traité des devoirs, Cicéron écrivait il y a vingt siècles : « Quand les circonstances et la nécessité l’exigent, nous devons entrer dans la mêlée et préférer la mort à la servitude. » Ces lignes issues des profondeurs de notre culture n’ont en rien vieilli et peuvent parfaitement s’appliquer à la pandémie actuelle. Être libre ou se reposer, il va falloir choisir.
Pour qu’il n’y ait pas un jour à demander : la liberté, pour quoi faire ?
PATRICE FRANCESCHI ; 13 AVRIL 2020
