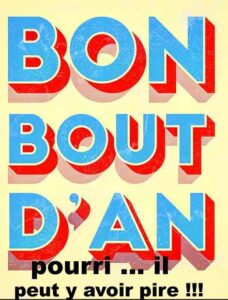« Trente ans de diabolisation ont montré leurs limites », entend-on de plus en plus
Mais la vérité c’est qu’il n’y a jamais eu de diabolisation. Du Diable on ne dit pas qu’il pose les « vraies questions ». Ce qui a amené les fascistes au portes du pouvoir d’État en 2022 n’est pas une diabolisation mais justement trente-huit ans de dédiabolisation, de banalisation, de légitimation… bref : de lepénisation. Le texte qui suit revient sur ces décennies de dérive politique, médiatique, culturelle, ainsi que sur la notion de lepénisation
La présence de Jean-Marie Le Pen au second tour à l’élection présidentielle en 2002, l’existence d’une profonde discrimination selon l’origine réelle ou supposée, les profanations de lieux religieux (synagogues, mosquées, cimetières) : tous ces phénomènes et bien d’autres témoignent de la persistance d’un profond racisme en France. Depuis longtemps, philosophes, historiens, sociologues, mais aussi militants antiracistes se sont efforcés d’expliquer ce phénomène, et depuis 2002 une explication semble s’être s’imposée : le racisme se nourrit des effets de la crise économique – chômage, précarité, détérioration des liens sociaux et des conditions de vie dans les quartiers populaires. Une explication insuffisante, voire pernicieuse, que le concept de « lepénisation » permet de contester.
Cette explication, que semble étayer le fort taux de vote pour le candidat du Front national parmi les ouvriers, présente un intérêt certain : plutôt que de renvoyer à des processus psychologiques, voire à une nature humaine invariablement méfiante par rapport à l’étranger, elle souligne l’impact de processus sociaux et économiques. Le racisme est ainsi appréhendé comme une production sociale. Pourtant, en le ramenant à un simple comportement de protestation, ce schéma ne prend pas en compte les opinions racistes comme des phénomènes autonomes, non réductibles à l’expression d’une colère sociale. Il tend également à passer sous silence les conséquences concrètes du racisme pour les populations qui le subissent. Enfin, il repose sur un certain nombre de présupposés qu’Annie Collovald s’est récemment attachée à réfuter.
Dans ce livre important, Le « populisme du FN », un dangereux contresens, l’auteure montre, à l’aide de données électorales précises, le caractère erroné des analyses qui voient dans les classes populaires les principaux soutiens du Front national. Intégrer l’abstention et la non inscription sur les listes électorales, beaucoup plus importantes chez les classes populaires, permet de donner une plus juste mesure du pourcentage d’électeurs FN au sein de cette population. Les commerçants et professions indépendantes apparaissent alors comme les premiers soutiens du parti d’extrême droite. Dans son livre, Annie Collovald retrace la genèse de ce sens devenu commun chez les spécialistes du commentaire politique, et surtout, elle invite à s’interroger sur ses effets sociaux. Avec cette analyse, en effet, s’impose « la figure fantasmatique d’un peuple menaçant pour la stabilité de la démocratie », « délégitimant tous ceux pour qui le “peuple“ est une cause à défendre au profit de la légitimation de ceux qui pour qui le “peuple“ est un problème à résoudre ». Le peuple porterait ainsi une responsabilité, compréhensible mais écrasante, dans la persistance du racisme en France.
Centrant l’explication de la crise de la démocratie et de la représentation politique sur les classes populaires, cette analyse a aussi pour effet d’exonérer les élites politiques et médiatiques de toute responsabilité. Or c’est précisément le rôle joué par la classe politique et les médias dans la montée du Front national que nous voudrions souligner, ouvrant ainsi à une autre approche du racisme. Le racisme, comme nous avons voulu l’expliquer dans notre Dictionnaire de la lepénisation des esprits, n’est pas, ou pas spécialement, une caractéristique de la « France d’en bas » ; il est même, à beaucoup d’égards, une production de la « France d’en haut », et le résultat de la réappropriation dans ses discours de grilles d’analyse, d’arguments, de schémas de pensée d’extrême droite. À quelle réalité renvoie ce que le ministre socialiste Robert Badinter avait, le premier, qualifié de « lepénisation des esprits » ? Quelle forme a-t-elle prise et jusqu’où s’est-elle étendue ?
Cette histoire n’est pas linéaire, mais deux épisodes marquants s’en dégagent : la politisation, à partir de la fin des années 1980, de la question de l’immigration et la focalisation des débats politiques autour du « problème de l’immigration » ; la montée en force, dans la seconde moitié des années 1990, des discours sécuritaires centrés sur les jeunes des classes populaires.
Le « problème de l’immigration »
Longtemps confinée au sein de l’administration, la question de l’immigration a fait l’objet, à partir de la fin des années 1970, d’une politisation croissante. Investie par les associations, les médias, la classe politique, elle est devenue un des objets de clivages politiques et de débats publics. Mais, loin d’être posée de façon « neutre », cette question a été problématisée d’une certaine manière. Alors que les mouvements et les associations de gauche et d’extrême gauche engagés dans cette cause voyaient leur influence décliner, l’analyse a été recadrée à la fin des années 1980 sur les problèmes que poseraient les immigrés (et non plus ceux qu’ils subissent), que ce soit à la France, à la situation de l’emploi, aux déficits publics ou encore au niveau de délinquance.
Outre les médias, cette évolution doit beaucoup à un certain nombre de déclarations politiques prenant pour cible les immigrés. Si des personnalités de gauche (comme le Président François Mitterrand ou le Premier Ministre Michel Rocard) ont pu participer à la désignation des immigrés comme menace, la lepénisation des esprits est d’abord le fait de la droite. Jusqu’au début des années 1990, le Parti socialiste cherche à éviter la question de l’immigration, ou alors met l’accent sur le premier volet du diptyque sur lequel va reposer la politique d’immigration en France, quels que soient les gouvernements successifs : l’« intégration » des immigrés ayant vocation à rester sur le territoire français et l’éloignement des irréguliers. Au Parti communiste, les amalgames entretenus entre drogue, délinquance et immigration sont régulièrement repris par certains maires (notamment ceux de Vitry et de Montigny-lès-Cormeilles). La direction nationale, qui initialement leur apporte son soutien, évolue toutefois, à partir de la fin des années 1980, vers d’autres positions sur la question de l’immigration, soulignant la négation des droits de l’homme et l’exploitation économique des sans papiers.
C’est donc avant tout à droite, et depuis la décision de fermer les frontières en 1974, que se développent les discours les plus répressifs à l’encontre de l’immigration, d’abord en vue d’encourager les retours d’immigrés installés en France, ensuite, devant l’échec de cette politique, pour lutter contre les arrivées régulières et irrégulières. En 1986, le ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, s’illustre en procédant à l’expulsion collective de « 101 Maliens ». Des pratiques et un discours répressifs s’imposent, toujours plus médiatisés et progressivement banalisés en dépit des protestations qui peuvent s’exprimer.
L’orientation répressive se renforce au fur et à mesure que l’échec de la politique économique libérale « dure » menée par le gouvernement Chirac en 1986 apparaît patent. La question de l’immigration va devenir, après 1988, un vrai cheval de bataille. Un angle d’attaque privilégié est ainsi trouvé pour attaquer la gestion de la gauche. Mais l’objectif consiste aussi, en multipliant les déclarations de « fermeté » à l’encontre des immigrés, à récupérer les voix du Front national, dans les années où ce parti se développe considérablement, jusqu’à conquérir plusieurs sièges à l’Assemblée nationale et dans les conseils régionaux, ainsi que quelques mairies.
Au sein du discours qui se développe ainsi, deux idées, directement issues de la rhétorique d’extrême droite, reviennent sans cesse, pour gagner un caractère d’évidence de plus en plus partagée. La thématique de la menace va d’abord s’incarner dans la dénonciation d’une « invasion ».
Invasion
« Nous sommes victimes d’une invasion apparemment pacifique mais qui, évidemment, nous menace mortellement dans notre identité et notre sécurité », Jean-Marie Le Pen
« Le type de problèmes auxquels nous allons être confrontés n’est plus l’immigration, mais l’invasion », Valérie Giscard d’Estaing, UDF
« Intrusion, occupation, invasion. Les trois mots sont exacts. Pour invasion, je suis reparti consulter le dictionnaire qui donne deux définitions : action de pénétrer et de se répandre dangereusement. Et il n’est pas innocent de le comprendre. Un million de clandestins, c’est l’effectif de cent divisions, non armées certes, mais qui pèsent lourdement sur les conditions de notre existence et de notre identité nationale », Michel Poniatowski, UDF
« Ce qui était une immigration de renfort démographique devient une immigration de substitution de peuplement », Jean-Louis Debré, RPR
« Je suis maire d’une commune dans laquelle se trouvent des écoles où il y a 60 de non francophones. Je le dis calmement avec sérénité. Cela pose des problèmes aux élus locaux et cela posera dans l’avenir aux Français des problèmes considérables (…) Dans les Bouches-du-Rhône, si l’évolution actuelle se poursuit, s’il n’y a pas de diminution de la communauté étrangère, dans quelques années (probablement avant la fin du siècle), il y aura plus d’étrangers que de Français de souche », François Léotard, UDF
« Osons avancer une hypothèse : si 10% des 500 millions de jeunes Africains que l’Afrique comptera en 2025 venaient tenter leur chance en Europe chaque année, ce sont entre 30 et 50 millions de jeunes Africains qui arriveraient, soit la population d’un pays comme l’Espagne, c’est dire l’ampleur du problème que nous avons à gérer », Daniel Colin, RPR
« Les nations existent. Chacun défend son existence légitimement », Jean-Pierre Chevènement, MDC
Ce vieux thème de l’extrême droite française, très prisé par Jean-Marie Le Pen, a été repris explicitement par la droite parlementaire au début des années 1980. « Il faut arrêter cette invasion », pouvait-on lire en 1983 dans un trac de Roger Chinaud et Jean-Pierre Bloch (UDF) en faveur du candidat Alain Juppé (RPR). Il est revenu en force au début des années 1990 et l’on a pu entendre le député RPR Jacques Myard prophétiser « la guerre civile » si rien n’était fait pour contenir les « hordes qui déferlent sous la pression démographique du Sud ». Ce discours fait apparaître les immigrés, non plus seulement comme des parasites ou comme un « problème » à régler, mais aussi comme des agresseurs, justifiant ainsi la violence qui leur est faite en la faisant passer pour un acte de légitime défense. Basé sur des analyses erronées (et maintes fois réfutées, notamment sur le lien entre immigration et chômage, immigration et déficits de la sécurité sociale, immigration et délinquance), ce discours occulte en outre l’histoire d’une autre « migration », celle des colonisateurs français dans les pays du Maghreb et de l’Afrique noire, des violences qu’ils ont perpétrées et de la déstructuration de ces sociétés qui est aussi un des facteurs des migrations actuelles.
Ce discours sur l’invasion a été d’autant plus efficace qu’il est venu se greffer – deuxième thématique sur laquelle nous voudrions insister ici – sur une certaine conception de la nation française. L’immigration ne peut en effet être présentée comme un danger pour la France que parce que celle-ci est conçue comme une entité basée sur une « identité » homogène et immuable à travers des siècles. Cette nation, garantie par l’existence d’un socle de populations « de souche », héritière de valeurs communes, ne pourrait par conséquent se perpétuer qu’en limitant l’arrivant de corps « étrangers ». Cette conception nationaliste, construite sur un modèle « organiciste », nie l’histoire déjà longue de l’immigration en France, mais aussi les conditions sociales et économiques de l’intégration des immigrés. Cette vision se traduit surtout par une série de déclarations sur le « seuil de tolérance » et d’appels répétés à la mise en œuvre de « quotas ».
Seuil de tolérance
« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité ; sinon la France ne serait plus la France. (…) Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et après-demain quarante ? (…) Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-deux-Eglises, mais Colombey les deux Mosquées ! », Charles de Gaulle
« Il y a une overdose d’immigration », Jacques Chirac, RPR
« Le seuil de tolérance est franchi », Alain Juppé, RPR
« Le seuil de tolérance est dépassé depuis les années 1970 », François Mitterrand
« L’immigration est absorbable à petites doses », Jean-Pierre Chevènement
L’insécurité et les nouvelles classes dangereuses
La manière de parler de l’immigration connaît certes, durant cette période, un changement positif : sans doute en raison de la légitimité acquise par les luttes de sans-papiers, la désignation du « clandestin » comme figure de la menace est devenue moins efficace, et donc moins mobilisée. Mais le contre-feu raciste ne tarde pas à se mettre en place : la « question de l’immigration » laisse la place à celle de l’« insécurité », et à la thématique de l’invasion venue de l’extérieur se substituent la mise en garde contre « la délinquance, l’insécurité et l’incivilité », l’incrimination de mineurs « de plus en plus jeunes et de plus en plus violents », la désignation de « zones de non droit où la police ne va plus » et l’invocation d’une « crise de l’autorité, des repères et des valeurs ». De cette situation, « l’angélisme et le laxisme » seraient responsables, comme on nous l’a continuellement répété à partir de 1997.
Cette analyse se généralise dès le début des années 1990. La politique de la ville mise en œuvre par la gauche sur les quartiers dits sensibles, axée sur la « participation » des habitants et la « restauration du lien social », fait alors l’objet de critiques virulentes. Gérard Larcher explique par exemple dans un rapport parlementaire que cette politique, trop sociale à son goût, occulte la responsabilité des habitants et notamment des jeunes dans les problèmes de ces quartiers.
Mais c’est, il faut bien l’admettre, le retour de la gauche au pouvoir au printemps 1997 qui marque le tournant décisif puisque cette dernière opère un spectaculaire ralliement de la gauche gouvernementale à l’idéologie dite sécuritaire. Le Parti socialiste remporte en effet les élections de juillet 1997 sur la base d’un programme énonçant « trois priorités : l’emploi, la santé et l’éducation », et quelques semaines plus tard, dans son discours d’orientation générale, le premier ministre Lionel Jospin annonce finalement « deux priorités : l’emploi et la sécurité ».
Il y a donc eu un choix politique délibéré : rien, ni dans les sondages ni dans le champ politique, ne pousse alors la gauche à adopter une telle politique. La droite vient de subir une cinglante défaite électorale, le Front national connaît une crise profonde en raison de la scission entre le FN et le MNR, et la délinquance n’arrive qu’au cinquième rang des « préoccupations des Français », derrière le chômage, la pauvreté, la maladie et les accidents de la route. Elle ne deviendra la première préoccupation qu’après plusieurs années d’une intense campagne médiatique et politique.
Le ralliement de la gauche gouvernementale aux dogmes sécuritaires est officialisé au colloque de Villepinte en octobre 1997 : Lionel Jospin et son ministre de l’intérieur Jean-Pierre Chevènement y déclarent que « la sécurité est une valeur de gauche », en l’inscrivant dans la filiation du « droit à la sûreté » de la Déclaration des Droits de l’Homme. Cette évolution sera légitimée par une série de tribunes, rapports et expertises fortement médiatisées : rapport sur les mineurs délinquants des députés socialistes Christine Lazerges et Jean-Pierre Balduyck publié en avril 1998 (et proposant d’instaurer un couvre-feu et de « responsabiliser les parents de délinquants » par la suppression des allocations familiales) ; manifeste lancé en septembre 1998 par neuf intellectuels, intitulé « Républicains n’ayant plus peur ! » appelant à refonder la République en « restaurant l’autorité » et en instaurant la « tolérance zéro des petites infractions » pour les mineurs des « quartiers sensibles » ; publication en 1999 d’un Que sais-je ? sur les Violences et insécurités urbaines écrit par un ancien militant d’extrême droite (Xavier Raufer) et un entrepreneur en sécurité (Alain Bauer), qui expliquent qu’« au-delà de toutes les théories d’inspiration sociologique, l’origine la plus certaine du crime, c’est le criminel lui-même ».
Plusieurs livres ont déjà mis en cause la pertinence du diagnostic avancé par le gouvernement Jospin pour justifier le virage sécuritaire. On insistera ici sur ses conséquences. Car ce tournant sécuritaire ne se limite pas à des discours : il s’est traduit concrètement par une législation de plus en plus répressive, et une légitimation accrue des abus policiers. La loi sur la sécurité quotidienne, votée à la quasi unanimité en 2001, crée par exemple un nouveau délit, la « fraude habituelle » : les personnes interpellées dix fois pour fraude dans les transports en commun sont désormais passibles de six mois de prison et de 7500 euros d’amendes. Une autre loi votée au même moment autorise les forces de police à déloger les jeunes qui se regroupent dans les halls d’immeuble, même si aucun délit n’a été commis.
Ce tournant sécuritaire participe de la lepénisation des esprits dans la mesure où il entretient et attise la stigmatisation des classes populaires, et plus particulièrement de la jeunesse immigrée ou issue de l’immigration, dont la présence et les comportements sont présentés comme la cause des problèmes. Et si la menace ne semble plus provenir de l’extérieur du pays, le discours sécuritaire souligne toutefois de manière quasi-systématique l’origine « étrangère » de ces populations, en la présentant comme un élément crucial des problèmes sociaux. Le rapport Bénisiti, rédigé par un député de droite en 2004, constitue l’aboutissement de ce processus : consacré aux problèmes de délinquance, il met en cause le bilinguisme des enfants issus de l’immigration et appelle à stopper l’apprentissage de tout « patois » au sein de ces familles.
La volonté exprimée par Sarkozy en novembre 2005 d’expulser les émeutiers étrangers hors de France procède d’une même grille de lecture : il véhicule sournoisement l’idée que les « agitateurs » sont forcément des étrangers et consacre un fonctionnement républicain qui, loin de l’indifférence aux origines dont se prévaut la République, ne cesse de produire et d’institutionnaliser des catégories ethnicisées et essentialisées. Des « sauvageons » dont parlait le ministre de l’intérieur Jean-Pierre Chevènement aux « racailles » évoqués par son homologue du gouvernement Raffarin, on retrouve ce double processus de stigmatisation caractéristique des nouvelles classes dangereuses : l’insistance sur la délinquance et la focalisation sur les origines étrangères.
La montée en force des grilles de lecture sécuritaires a ainsi directement conforté l’analyse de Jean-Marie Le Pen selon laquelle les problèmes sociaux renverraient aux comportements déviants d’une population étrangère mal intégrée. Cette lepénisation des esprits, qui a rendu possible la présence du leader du Front national au second tour des élections présidentielles de 2002 sans même qu’il ait besoin de faire campagne, a eu des effets redoutables pour la gauche. L’hégémonie de l’approche raciste et culturaliste des problèmes sociaux s’opère aux dépens des grilles d’analyse sociales portées par la gauche depuis le dix-neuvième siècle : l’idée que les déviances sociales ne relèvent pas simplement de comportements individuels à réprimer mais renvoient à des causes socio-économiques, sur lesquelles seule une action collective peut jouer peut jouer.
Et de fait, dès la fin des années 1980, il est devenu quasiment impossible au sein de la classe politique française d’aborder l’immigration sans partir du constat d’un problème posé par l’immigration à la France. C’est donc d’un même mouvement son identité sociale et son identité antiraciste qu’abandonne le Parti socialiste : tout se passe comment si les dirigeants de ce parti avaient renoncé à voir dans les immigrés et leurs descendants des alliés ou des victimes à défendre pour les présenter avant tout comme des fauteurs de troubles. En dépit de la création par la ministre Martine Aubry de l’éphémère Groupe d’études et de lutte contre les discriminations, ce combat ne sera jamais une priorité politique, alors même que plusieurs études témoignent d’une discrimination massive, que ce soit dans l’emploi ou dans le logement, ou encore face à la police.
Le « péril islamiste »
Depuis lors, on observe une certaine continuité. Au sauvageon incriminé par Jean-Pierre Chevènement fait écho la racaille dénoncée par Nicolas Sarkozy. Mais une différence de taille sépare les deux discours : là où le ministre de Jospin organisait tout son propos autour d’une opposition entre « la République » porteuse de droit et d’égalité et les jeunes délinquants en perte de repères, c’est sa propre personne que Nicolas Sarkozy présente comme recours face à la « racaille ». À cet égard, ce ne sont plus seulement des relents racistes que l’on entend mais une valorisation de la figure individuelle du chef guerrier et viril (comme le sous-entend d’ailleurs la figure phallique du karcher dans la célèbre saillie du candidat Sarkozy). Une figure caractéristique du lepénisme comme de tous les fascismes.
Ces figures plus ou moins fantasmées autour desquelles s’est organisé le débat public – au détriment par exemple du chômeur ou de l’ouvrier – n’ont cessé d’évoluer, en se focalisant notamment sur l’Islam et sur deux figures-repoussoir : le barbu et la voilée. La conception culturaliste et à relents racistes d’un « choc des civilisations » fait ici sentir son influence, renforcée après le 11 septembre et la campagne bushienne contre l’Irak. Théorisée initialement par Samuel Huntington, cette thèse s’incarne aujourd’hui dans une doxa largement reprise en France, opposant un Islam par essence dangereux, violent et obscurantiste à un Occident incarnant les valeurs de laïcité, de liberté et d’égalité.
Cette focalisation récente sur les populations maghrébines, d’origine maghrébine ou plus largement associées au « monde musulman » nous incite à nous interroger, au-delà de l’influence de l’extrême droite française, sur le rôle que joue, dans la persistance du racisme, l’imaginaire et l’idéologie coloniale – une idéologie qui a irrigué l’ensemble de la classe politique et de la société française.
Pour lire le texte complet :
https://lmsi.net/De-lepenisation-a-la-zemmourisation-des-esprits