L’abolition de la police, une dangereuse utopie ?
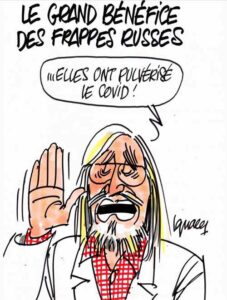
Loin d’être absurde, cette idée a le vent en poupe face aux nombreuses violences d’État. Elle part d’une proposition simple : ne plus déléguer notre sécurité à une force qui n’a pas été créée pour tous nous protéger.
L’autre programme — Que pourrait faire un gouvernement pour engager la transformation de la société ? Travail, démocratie, fiscalité, agriculture, énergie… Reporterre vous propose d’explorer, par des reportages et des enquêtes, quelques mesures de rupture écologique et sociale.
Le ton monte chez vos voisins. Ce n’est pas la première fois, mais cette fois-ci, la dispute semble dégénérer. Que faites-vous ? Une amie vous confie qu’elle a subi une agression sexuelle. Que lui conseillez-vous ? Vous retrouvez un matin votre porte de garage taguée, comme plusieurs de vos voisins. Que décidez-vous collectivement ?
Votre réaction sera probablement de vous tourner vers la police. Mais vous pouvez aussi faire le choix d’apprendre à vous passer d’elle. Abolir, défaire la police. Le mot d’ordre vient des États-Unis, où l’idée est développée déjà depuis une vingtaine d’années, dans le sillage des mouvements pour l’abolition de la prison. Elle est revenue sur le devant de la scène en mai 2020. George Floyd, un Africain-Américain de 46 ans, était mis à mort par un policier de Minneapolis, étouffé pendant près de neuf longues minutes intégralement filmées.
Ce meurtre a déclenché un soulèvement à Minneapolis, qui s’est propagé dans d’autres villes des États-Unis. Le mouvement Black Lives Matter (« la vie des Noirs compte ») réclamait l’abolition de la police, l’arrêt de son financement. Au point que seulement deux semaines après la mort de George Floyd, le conseil municipal de Minneapolis annonçait le démantèlement de sa police [1].
En France, l’idée a également été évoquée à l’occasion de la médiatisation du mouvement Black Lives Matter de 2020. Mais elle perce à peine. Deux recueils de textes parus à l’automne 2021 l’abordent : Abolir la police, du collectif Matsuda, traduit des textes étasuniens sur le sujet et Défaire la police (éd. Divergences) réunit des textes originaux de différents auteurs (Jérôme Baschet, Elsa Dorlin, Irène, Guy Lerouge, le Collectif Matsuda et Serge Quadruppani). Dans les milieux militants, on commence à en discuter. « On en est aux premiers pas », dit à Reporterre Ian B, du collectif Désarmons-les. « Avant la mort de George Floyd, cela se cantonnait aux milieux universitaires et anti-carcéraux. » Amal Bentounsi, fondatrice du collectif des familles des victimes tuées par la police, a entendu parler de l’idée mais n’y adhère pas : « Nous, ce que l’on demande, c’est que le mécanisme juridique fonctionne sans dérailler. »
« Créer des communautés plus fortes afin de pouvoir se passer de police »
À première vue, se passer de police peut paraître une idée, au choix, dangereuse ou utopique. « Être abolitionniste, ce n’est pas prôner la loi du plus fort », corrige Gwenola Ricordeau, professeure en justice criminelle à la California State University, dans un entretien publié sur le site Acta Zone. Il s’agit plutôt d’apprendre collectivement à assurer sa sécurité de façon autonome. La traduction est très concrète. « L’idée est davantage de créer des communautés plus fortes afin de pouvoir se passer de police. […] Il s’agit, par exemple, de se former à la gestion des situations de violences interpersonnelles […], ou à intervenir auprès de personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui consomment des produits psychoactifs », poursuit la chercheuse.
« Combien d’appels au 911 [le numéro d’urgence aux États-Unis] nécessitent vraiment l’intervention de personnes qui portent des armes ? », s’interroge dans l’un des textes traduit par Matsuda le collectif de Minneapolis MDP 150. Il demandait déjà avant la mort de George Floyd la fin de la police. Pour les militants, l’action de la police est souvent contre-productive et ajoute de la violence. Par exemple pour les personnes atteintes de maladie mentale faisant une crise. « La police est la première à être envoyée sur place », regrette le collectif. Les conséquences sont dramatiques : « Un quart des meurtres policiers annuels, aux États-Unis, sont considérés comme liés à des problèmes de santé mentale », signale le traducteur du texte.
Le mouvement féministe anticarcéral milite également beaucoup contre l’idée que la police permettrait de lutter contre les violences sexuelles. « Il y a beaucoup de violeurs en prison ? » interrogeait la militante féministe basque Irène, dans un entretien vidéo sur lundisoir. « Je ne vais pas confier ma sécurité à un corps aussi viriliste que celui de la police, incarnation du patriarcat ! »
Pour les abolitionnistes, la majeure partie des missions dévolues à la police pourrait donc être assurées par d’autres instances : des membres de la communauté, des associations, etc. Ils suggèrent de rediriger les fonds qui servent à entretenir la police vers la prévention des causes de la violence.
Le MDP 150 liste des alternatives qui existent déjà ou qu’il incite à développer : mettre en place un service « qui envoie des intervenants qualifiés en santé mentale à toute heure du jour ou de la nuit » ; augmenter « le nombre de lits disponibles dans les foyers » et construire « davantage de logements abordables » plutôt que d’ « envoyer la police arrêter tous les sans-abris » ; renforcer les associations qui luttent contre les violences sexuelles, l’exploitation sexuelle et la violence conjugale ; légaliser les drogues car « la guerre contre la drogue a été très efficace pour criminaliser systématiquement les communautés de personnes de couleur » ; enfin, concernant les vols, « la meilleure façon de réduire les délits contre les biens n’est pas d’emprisonner les pauvres […] il s’agit d’investir dès le départ dans les communautés afin que les gens aient moins besoin de se voler les uns les autres », estime le MDP 150.
Si l’abolition reste l’objectif de long terme, il s’agit de façon très pragmatique de mettre en œuvre « la diminution ici et maintenant, par les personnes elles-mêmes, de l’emprise policière sur leurs vies », résume le collectif Matsuda dans son introduction.
Plus largement, l’abolition de la police ne va pas seule. « La police est le début de la « chaîne pénale » », rappelle Gwenola Ricordeau, qui milite pour la fin des « institutions dont le rôle est de réprimer ou de punir », que sont la police, les tribunaux et la prison. Mais alors, que faire des criminels ? Comment réparer le tort fait aux victimes ? Les militants testent d’autres formes de justice. Le but est la guérison de la victime et du mal fait à la communauté, mais aussi d’éviter que le coupable ne recommence, afin de briser le cycle de la violence.
Abolir la police cite l’exemple du collectif Chrysalis, qui a suivi un processus de justice transformatrice pour répondre à un cas de viol en milieu militant. Il a d’abord « formé un groupe de soutien à la survivante », puis un autre groupe de « responsabilisation », chargé de discuter avec l’agresseur pour « le rendre responsable de ses actes et l’amener à changer ».
L’exemple zapatiste
Une autre expérience « d’autre justice » est celle de l’autonomie zapatiste, au Chiapas. Cette « justice de médiation » est décrite dans un texte de Jérôme Baschet, publié dans l’ouvrage collectif Défaire la police. Les habitants exercent à tour de rôle la charge de rendre la justice. « Celles et ceux qui ont la charge temporaire des instances de justice autonomes réunissent les parties, les écoutent et enquêtent lorsque c’est nécessaire, puis les invitent à trouver un accord permettant de parvenir, si possible, à une réconciliation », décrit l’auteur. Le but est d’obtenir une « réconciliation entre les parties mais aussi avec la communauté dans son ensemble dès lors que ses règles, établies et acceptées par tous, ont été enfreintes. » L’accord peut prévoir une réparation pour la victime.
« Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est ce principe qui s’applique également dans le cas […] d’un homicide. La solution […] repose souvent sur la cession d’une terre », précise Jérôme Baschet. « Les instances en charge de la justice ont moins pour logique de déterminer les délits et les peines que d’affronter les problèmes portant atteinte au tissu de la vie collective et de rechercher les solutions », observe-t-il encore.
« Tu prends en main ton existence »
La Zad de Notre-Dame-des-Landes a également expérimenté, jusqu’à l’intervention militaire d’avril 2018, une organisation sans système pénal. « On va pas appeler les flics pour régler les problèmes, donc on s’organise », racontait à Reporterre Sylvie Thébault, une des agricultrices résistantes. « C’est très riche, tu prends en main ton existence, mais cela demande aussi beaucoup d’énergie. » La discussion, individuelle ou entre collectifs, était alors la solution privilégiée par les habitants de la Zad pour résoudre leurs conflits. À une période, un groupe de douze personnes dont la moitié était renouvelée tous les quinze jours a également été mis en place, avec pour tâche de servir d’intermédiaire en cas de conflit. Mais certains cas n’ont pas trouvé d’autre solution que l’exclusion de la Zad. « Récemment, on a viré un mec, nous expliquait Émilie en 2016. […] Il avait des comportements sexistes à répétition, dans les paroles et dans les actes. Cela faisait trois ans qu’on lui expliquait que cela posait problème. »
Les militants abolitionnistes américains ne se contentent pas de mettre en place des alternatives à la police. Ils cherchent aussi à réduire son champ d’action et ses moyens. Parmi les propositions relayées par Gwenola Ricordeau et le collectif Matsuda : réduire le financement de la police, lutter pour son désarmement, libérer les prisonniers. « Il y a plein de tactiques mises en place pour affaiblir la police qui peuvent être utilisées en France », estime Gwenola Ricordeau, comme « des revendications de dissolution de certaines forces de police — je pense évidemment à la BAC, aux CRS, aux unités spécialisées dans la lutte contre les travailleuses du sexe ou les usager⋅e⋅s de produits stupéfiants. »
- Mais attention, avertissent les abolitionnistes, il ne faut en revanche surtout pas promouvoir des mesures qui pourraient tendre à renforcer la police. La formation des policiers peut légitimer l’extension de leur champ d’intervention (par exemple par la formation à la gestion des violences conjugales). La police de proximité sert à lui donner une bonne image. Les mesures pour mieux surveiller l’action de la police pourraient laisser croire que les violences policières ne sont que des dérapages et pas le fruit d’un problème systémique. Le collectif Matsuda relève l’exemple du policier Derek Chauvin, meurtrier de George Floyd : « il avait fait l’objet de dix-huit signalements internes […], avait suivi une formation sur les préjugés raciaux, une autre sur la désescalade lors d’interventions. »
« On ne peut pas réformer une institution intrinsèquement raciste », explique ainsi Clara Garcia-Rojas, doctorante et militante abolitionniste dans une interview à Vice. « L’histoire du policing est ancrée dans la suprématie blanche : les patrouilles d’esclaves (slave patrols) sont apparues pour poursuivre, chasser et parfois tuer les esclaves fugitifs, et pour protéger les personnes blanches et leur propriété. » Il y a un « lien historique entre apparition de la police, début de l’esclavage et naissance du capitalisme », confirme le collectif Matsuda. « Il faut déconstruire l’idée que la police est là pour nous protéger », appuie Ian B de Désarmons-les.
Ces deux derniers interlocuteurs reconnaissent cependant qu’ils n’ont pas encore toutes les réponses aux questions posées par l’abolition de la police. « On a fait des ateliers pour imaginer comment se passer de police, les situations de violences avec armes étaient les seules où l’on n’avait pas de solution », raconte le collectif Matsuda. Ian B propose là encore le modèle zapatiste : « Les membres de la communauté peuvent assurer à tour de rôle la sécurité de la communauté. Mais dès qu’une arme est confiée à quelqu’un, il doit avoir à l’esprit qu’elle ne lui appartient pas, qu’une fois la mission terminée, l’arme est reprise. »
Il y a également de nombreux écueils à éviter. Un monde sans police pourrait aussi convenir aux plus riches, alors libres de déployer leurs propres arsenaux sécuritaires. Ou aux militants d’extrême-droite partisans des milices. Même assurées de façon communautaires, sécurité et justice peuvent ne pas être émancipatrices. C’est ce que rappelle Fabien Jobard, chercheur spécialiste des institutions pénales dans un texte envoyé à Reporterre : « Dans le monde d’aujourd’hui, la police est une denrée rare. […] La majeure partie de la sécurité quotidienne sur les continents africain et asiatique est assurée par des organisations privées […] « communautaires » ». L’histoire regorge aussi d’exemples d’organisations sans police, celle-ci ayant généralement été créée au XIXᵉ siècle en Occident. Autant d’exemples qui peuvent — ou pas — inspirer.
« Que les communautés puissent s’organiser met en danger l’ordre établi »
Reste à voir également si cette idée d’une sécurité assurée de façon communautaire pourrait s’adapter en France. « Il suffit de trouver quelque chose de l’ordre du commun, estime le collectif Matsuda. Le club de pêche, la famille, l’école, le comité d’entreprise sont autant de lieux où construire du lien. » Pour Ian B, la différence est surtout dans la façon dont les pouvoirs publics voient la communauté : « L’État français en veut aux communautés, aux solidarités de classe et de race car le fait que les communautés puissent s’auto-organiser, cela met en danger l’ordre établi. C’est cela qu’il appelle le « séparatisme ». »
Une société française sans police reste donc encore plus à imaginer qu’aux États-Unis. « En France, peu de collectifs se projettent clairement en direction d’un avenir sans police », constate le collectif Matsuda en conclusion de son ouvrage. Mais un nouveau champ des possibles est désormais ouvert, car la fin de la police va avec un nouveau modèle de société. L’horizon est révolutionnaire.
reporterre.net
