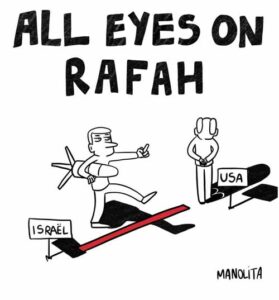
A propos de la BD Le monde sans fin de Jean-Marc Jancovici et Blain
Comme plus de 820 000 lecteurs, nous avons lu la bande dessinée Le monde sans fin, publiée en 2021. Ce livre resitue la crise climatique dans une histoire longue des sociétés humaines et de leur consommation énergétique et propose un scénario de « sortie de crise » basé sur… le nucléaire ! Si nous partageons un certain nombre de constats avec les auteurs, nous pensons que Le monde sans fin est emblématique de l’écologie technocratique qui a le vent en poupe, et qui est une fausse bonne idée – en fait, un vrai cauchemar.
Nous avons apprécié certains éléments du livre. Ainsi, il montre de façon pertinente que notre mode de vie dépend entièrement d’infrastructures matérielles énergivores, y compris dans des domaines où l’importance de l’énergie est souvent un impensé. Derrière chaque élément de confort dont on bénéficie (eau courante, électricité, chauffage, isolation, canalisations, câbles, routes nourriture, etc.) se cache une dépense d’énergie, qui repose sur la consommation de ressources (pétrole, nucléaire, hydroélectricité…)1.
Le monde sans fin essaye de mettre en perspective les liens entre les structures sociales, la productivité et la consommation d’énergie. Le livre rappelle par exemple que si la productivité agricole a été très largement augmentée au cours des dernières décennies, cela s’est fait au prix d’une dépendance au pétrole très importante. C’est le pétrole qui sert à nous nourrir et à nous épargner des efforts. Le livre décrit même un rapport causal entre abondance énergétique et changements sociaux. L’« État Providence » (congés payés, aides sociales, services publics de qualité…) est apparu en même temps que l’énergie abondante. Le monde sans fin affirme que c’est parce que la productivité et les richesses ont augmenté que les luttes sociales ont pu imposer une meilleure répartition des richesses. Mais ce lien est présenté par les auteurs comme mécanique, nécessaire. Nous y reviendrons.
Parmi les autres points que nous pourrions reprendre à notre compte, il y a le rappel que les énergies renouvelables ne remplacent aucune autre source d’énergie, mais qu’elles s’y ajoutent : il n’y a pas d’énergie verte, chaque type d’énergie a ses inconvénients lorsqu’elle est utilisée massivement. Par exemple, le solaire artificialise des terres, l’éolien demande beaucoup d’espaces, dégrade les sous-sols, et les deux demandent beaucoup de métaux pour leur construction, tout en ne durant que peu de temps…
Et puis, évidemment, Jean-Marc Jancovici défend des propositions de bon sens : relocaliser la production, ne pas tenir pour responsables du désastre environnemental les agriculteurs (qui en sont en partie les victimes), supprimer les centres commerciaux, privilégier des aménagements où on peut se déplacer à pied, etc.
Réductionnisme énergique
Pourtant, au-delà de ces préoccupations communes, la vision politique exposée dans cette bande dessinée nous semble faire partie du problème, et non des solutions. En effet, cette vison est formée sur le même modèle que celle qui nous a conduits à l’impasse actuelle : c’est une vision d’expert. L’expert, c’est celui qui se présente comme un simple interprète de forces supposées prédictibles. C’est celui grâce à qui on pourrait analyser scientifiquement l’ensemble des forces en présence et en déduire mécaniquement les décisions à prendre. Notre principale critique s’adresse à cette manière de penser qui ne donne le statut de connaissance qu’à ce qui est quantifiable. Le reste (l’amitié, l’expérience, les choix politiques, l’éthique…) serait négligeable. On peut qualifier ce raisonnement basé sur le calcul de pensée technicienne. Et cette pensée a hélas envahi bon nombre d’analyses de la crise écologique et de manières d’en penser des solutions.
Le monde sans fin applique ce qu’on pourrait appeler un réductionnisme énergétique : toutes les choses et tous les êtres (humains, voitures, plantes, structures sociales…) sont vus comme des systèmes convertisseurs d’énergie. Le cycliste convertit l’énergie organique en coups de pédales tout comme l’éolienne transforme la force du vent en électricité. Cycliste, éoliennes, animaux de trait, tracteurs, structures sociales : même combat. Ainsi, la bande dessinée assimile les êtres vivants à des machines. Considérés comme de simples vecteurs d’énergie, ils deviennent alors manipulables, gouvernables et prévisibles. Cette « écologie » à coups de « crédit individuel carbone »2 ouvre la voie à la tentation de l’ingénierie sociale. Celle-ci prétend réguler la vie des individus « pour leur bien et celui de la planète » en traitant les humains, les voitures, les plantes, comme des flux, des variables dans une équation.
Finalement, voici le cœur de l’argumentation du livre : l’énergie est ce qui nous permettrait d’échapper à la pénibilité d’une vie courte et misérable. Pour seule preuve, la répétition sans cesse que « c’était pire avant », ce qui est le meilleur moyen de relativiser notre mal-être présent et de couper court à toute contestation de la fuite en avant technologique : « Je n’en peux plus de la numérisation de l’administration, mais bon, avant on mourait à 30 ans. »
Société nucléaire, société autoritaire
Appliquant ce « technicisme », Le monde sans fin nous met face à un choix ultime : le nucléaire ou le chaos. En effet, le nucléaire est présenté comme un parachute d’urgence, obligatoire à utiliser – au moins provisoirement – pour surmonter les effets du dérèglement climatique. Et pour, éventuellement, aller vers une société où l’on consommerait moins.
Nous pensons au contraire que prôner le recours à l’énergie nucléaire est un moyen aberrant pour aller vers la décroissance. Le développement du nucléaire nous rend encore plus vulnérables aux conséquences du dérèglement climatique. Que surviendrait-il en cas d’accident nucléaire lié à l’accroissement de ce dérèglement ? Voyez l’impact des canicules et sécheresses sur la sécurité des centrales nucléaires qui, pour refroidir, ont besoin de beaucoup d’eau. De plus, il n’y a pas d’« atterrissage » possible avec le nucléaire, il ne peut être une énergie de transition : la gestion de ses déchets nous enchaîne à lui pour des milliers d’années, créant une dette insolvable3.
Par sa promotion du nucléaire, la vision portée par Jean-Marc Jancovici implique donc des compétences hyper spécialisées et hiérarchisées que seuls des États peuvent fournir, comme il l’affirme lui-même : « On ne fait pas de nucléaire de manière sérieuse dans un pays sans un État planificateur et constant »4. Son écologie est donc une écologie du haut, qui repose à la fois sur des spécialistes (à même de faire fonctionner des infrastructures ultra-complexes), et sur un État (à même d’assurer l’existence et la sécurité de ces infrastructures). Elle s’oppose radicalement à la nôtre, une écologie du bas mue par le principe d’autonomie, c’est-à-dire par la capacité à avoir une prise sur nos conditions d’existence, une écologie du plus grand nombre qui repose sur des savoirs assimilables et appropriables par tout un chacun.
Cette tendance techniciste gagne aujourd’hui du terrain. En atteste la popularité de Jean-Marc Jancovici, les ventes de cette BD ou le retour en force du nucléaire qui fait consensus de Macron à une certaine frange d’EELV et de ses sympathisants ; et c’est ce qui justifie que nous nous intéressions à cette bande dessinée trois ans après sa sortie. Le discours dominant centré autour du réchauffement climatique conduit à se focaliser sur la promotion de technologies dites « décarbonées », comme le nucléaire. Pourtant, se focaliser sur les émissions de CO2 occulte les autres composantes de la crise écologique : l’amenuisement des ressources, l’acidification des sols et des océans, la perte massive de biodiversité, les pollutions variées, etc. Surtout, cette grille de lecture ne remet pas en cause ce qui constitue le fondement de la crise écologique : le capitalisme industriel.
Bien loin de la question des émissions carbone, historiquement, c’est autour de la lutte contre le nucléaire civil que l’écologie politique a vu le jour en France dans les années 1970, avec des luttes comme celles de Fessenheim, Plogoff ou Creys-Malville. L’opposition des premiers écologistes au nucléaire reposait à la fois sur le risque que faisaient peser les radiations sur l’être humain et la nature, mais aussi sur le caractère antidémocratique et technocratique du nucléaire, ainsi que sur une critique du capitalisme industriel et de la société de consommation de masse qui l’accompagne. L’un des textes importants de l’écologie politique donne le ton : « Le nucléaire, dans la mesure où il comporte des risques irréversibles et où il est imposé de façon autoritaire, montre bien que les populations n’ont pas aujourd’hui le pouvoir de gérer leur vie. Gérer sa vie, c’est ça la Politique ! La politique, c’est enlever dès maintenant le monopole des décisions qui nous appartiennent des mains des technocrates et des experts scientifiques et politiques (…) Nous dénonçons un choix de société qui repose sur la surconsommation, née de l’étalage de la marchandise et de l’intoxication publicitaire et sur le gaspillage industriel, qui conçoit ces produits sans tenir compte de l’épuisement prochain des réserves de matières premières de la planète. » (Plateforme de Porsmoguer, 6 décembre 1975)
Son écologie et la nôtre
Le monde sans fin soulève pourtant un point très juste : critiquer la société industrielle doit nous conduire à rejeter une part immense de ce qui constitue nos quotidiens. C’est-à-dire l’abondance et le confort permis par l’industrialisation et les énergies fossiles. Mais que faire, alors ? Face à cette emprise du capitalisme industriel sur nos existences, c’est souvent un vide vertigineux qu’on imagine lorsqu’on évoque la déprise. Les écologistes radicaux sont alors sommés d’expliciter le futur souhaitable, et on nous pose tout un tas de questions existentielles auxquelles nous ne sommes pas en mesure de répondre. Quel degré de technologies serions-nous prêt-es à accepter ? Faut-il garder les IRM ? Les trains ? Les moissonneuses-batteuses ? Comment nourrir huit milliards d’êtres humains sans énergies fossiles ? Et quel programme pour décroître ? Etc. C’est à cet exercice périlleux que Jean-Marc Jancovici tente de répondre : comment changer de direction ? Et c’est une des raisons qui lui vaut ce succès, car il est rassurant lorsqu’on navigue en eaux troubles de s’imaginer suivre un cap !
Évidemment, ces questions ne sont pas absurdes : nous aimerions nous aussi pouvoir répondre à ce que serait un changement de cap. Mais nous savons à quel point il est malaisé d’aborder avec légèreté ces questions et de prétendre proposer un « programme », une « société idéale » clé en main. Ce serait en décalage complet avec la marche du monde : emballement de la consommation, explosion de la production, augmentation de la présence des technologies dans nos vies. De plus, il nous semblerait présomptueux d’esquisser les traits de la société que nous appelons de nos vœux tant les paramètres de ce qui constituera « le futur » sont inédits. De la gestion des communs négatifs (fleuves et nappes phréatiques contaminées, industries et technologies polluantes), au contexte géopolitique belliciste, en passant par le panel de possibles crises écologiques (zoonoses, grands feux, sécheresses, etc.) : comment prétendre suivre un plan de changement de cap quand le futur apparaît si incertain ? Et quand bien même ces paramètres seraient maîtrisables, est-ce bien à cinq ou six sur un coin de table en écrivant un article pour La nouvelle vague ou une BD pour Dargaud, qu’on fait des projets de société ? Ce n’est pas une question d’experts, cela devrait se débattre et se trancher de façon démocratique. C’est justement ce point qui fait la différence entre son écologie et la nôtre. Car si les réponses apportées à ces questions cruciales viennent d’en haut, l’« écologie » du futur pourrait bien se transformer en un véritable cauchemar.
Alors, nous pensons que c’est dans le présent qu’il convient d’agir, afin de saborder le futur promis. La marche du monde est au développement technologique, ce qui nous éloigne toujours davantage de nos capacités d’autonomie et de subsistance. C’est donc ce développement qu’il convient de freiner pour minimiser la dette à venir. Nous aspirons à une société du moins, de la limitation et de la simplicité. Une société humaine consciente du fait qu’elle s’inscrit dans un milieu écologique avec ses propres besoins, parfois antagonistes aux siens et avec lesquels il lui faut donc composer. Une société qui prenne en compte les limites spatiales, physiques, biologiques, temporelles, etc. que des décennies de développement technologique ont fait oublier en nous donnant l’illusion que tout est possible (hypermobilité, hyperconnectivité, abondance, déni du corps, de la terre, etc.). C’est guidés par des principes d’autonomie, de solidarité, d’émancipation et de responsabilité que nous cherchons à aiguiller le futur, en diffusant nos idées et grilles d’analyse. Afin que germent des alternatives à ces visions technicistes et autoritaires de l’écologie. Car l’écologie est une question politique, et non une question d’experts.
Ruptures, le 7 mai 2024
Article publié dans La nouvelle vague n°15, mai 2024.
Pour aller plus loin
- Jean-Marc Jancovici & Christophe Blain, Le monde sans fin, Dargaud, 2021.
- José Ardillo, Les illusions renouvelables. Énergie et pouvoir : une histoire, L’Echappée, 2015.
- Jaime Semprun & René Riesel, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2008.
- Tomjo, L’enfer vert. Un projet pavé de bonnes intentions, L’Echappée, 2013.
** **
Notes
(1) Nous avons évoqué ce point dans « Énergie : le virage autoritaire », La nouvelle vague n°7, décembre 2022.
(2) Le Journal des activités sociales de l’énergie, avril 2021.
(3) Nous avons fait l’historique du développement du nucléaire en France dans « Nucléaire : la société du risque », La nouvelle vague n°11, juin 2023.
(4) Le Journal des activités sociales de l’énergie, avril 2021.
