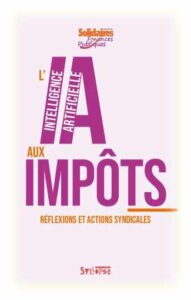
Une information d’Utopia 56
la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour « absence de protection » d’un mineur non accompagné (MNA). Elle devra verser 5 000 € au requérant pour dommage moral.
Le jeune guinéen s’était présenté aux services de protection de l’enfance du département début 2020. Suite à son évaluation, il n’a pas été reconnu mineur et a été remis à la rue.
Près d’un an plus tard, la Cour d’appel de Limoges constate finalement sa minorité et il peut réintégrer les services de la protection de l’enfance du département : il a droit à une mise à l’abri et devrait pouvoir aller à l’école.
Pendant plusieurs mois, ce jeune isolé s’est retrouvé à la rue, sans ressources, sans accompagnement autre que les associations, il est passé de squat en squat et a dû se débrouiller par lui-même pour suivre l’avancée de son dossier administratif, mais aussi se nourrir, se doucher, se protéger.
Ce quotidien, c’est celui des centaines de jeunes filles et garçons en recours que nous suivons dans nos différentes antennes. C’est le quotidien des 300 jeunes qui occupent actuellement la Gaieté Lyrique à Paris, c’était celui des 160 jeunes enfin mis à l’abri par la mairie de Lyon lundi dernier.
Tous ces jeunes n’iront pas devant la Cour européenne, car le parcours est long et complexe, pourtant tou⸱tes subissent le non-respect quotidien des Droits de l’enfant par la France.
** **
Combien de morts faudra-t-il dans la Manche avant que les États français et britannique ne prennent leurs responsabilités ?
Le 24 novembre 2021, la Manche engloutissait 27 vies humaines dans le naufrage le plus meurtrier qu’a connu cette mer devenue le symbole d’une crise ignorée.
Si ce naufrage reste celui qui a fait le plus grand nombre de victimes, l’année 2024 a battu un triste record. Depuis le début de l’année, ce sont au moins 70 personnes qui ont perdu la vie ou sont disparues en tentant la traversée. Les morts ne cessent pas. Pire, leur nombre se multiplie.Cette année, Rola, fillette de 7 ans, est morte noyée dans un canal sous les yeux de ses parents et ses grands frères, sans avoir même atteint la Manche. Maryam, un bébé de quatre mois, est morte noyée. Mansur, un enfant de 2 ans, est mort asphyxié. Des dizaines d’enfants, de femmes et d’hommes sont décédés à la frontière franco-britannique après avoir fui les conflits, la pauvreté, les persécutions, ou simplement parce qu’ils poursuivaient l’espoir d’une vie meilleure sur les rives anglaises.Il y a peu, Bruno Retailleau, fraîchement nommé ministre de l’Intérieur, portait l’indécence à son comble à l’occasion d’une rencontre avec son homologue britannique, en qualifiant les décès survenus au cours des semaines précédentes de « conséquences néfastes » de l’« efficacité » des forces de l’ordre.
Ces morts ne sont ni le fruit du hasard ni un simple dommage collatéral. Ils sont les conséquences directes des politiques migratoires sciemment mises en place par les pouvoirs publics français et britanniques pour rendre la vie des exilés sur le littoral nord impossible.
En effet, depuis 2021, les gouvernements français et britannique se sont engagés dans un coûteux projet de militarisation de la frontière, qui n’a fait qu’exacerber la souffrance, rendre toujours plus précaire la vie des personnes exilées ainsi qu’augmenter les risques et la dangerosité des traversées, au lieu d’ouvrir des voies de passage légales et sûres entre les pays.
Chaque nouvelle mesure répressive ne fait qu’aggraver la situation
La politique de démantèlement systématique des lieux de vie à l’œuvre sur le littoral nord n’a pour seule conséquence que d’augmenter la précarité et la vulnérabilité des personnes qui vivent dans les camps. Kazhall, par exemple, qui a perdu la vie avec ses trois enfants le 24 novembre 2021, avait été expulsée par la police du camp de Grande-Synthe la semaine précédant le drame. Parallèlement, la multiplication des obstacles aux passages a pour corollaire d’augmenter la dangerosité des traversées et de rendre le business des passeurs toujours plus lucratif.
Ces politiques n’empêchent pas les migrations. Elles forcent simplement les personnes à emprunter des routes toujours plus dangereuses et mortelles – jusqu’où devront-elles aller ? -, et participer à l’enrichissement des réseaux de passeurs – quand cela va-t-il cesser ?
À cela s’ajoute une autre injustice : trois ans après le naufrage du 24 novembre 2021, aucune enquête sérieuse n’a abouti. Certaines, promises, n’ont même pas été conduites, tandis que d’autres ont été entravées ou obstruées. Il n’y a eu ni responsabilité clarifiée ni vérité révélée. Cette inaction est un outrage aux familles des victimes et une négation de la dignité humaine. La justice doit être rendue pour que ces personnes ne soient pas seulement connues comme des chiffres, mais bel et bien reconnues comme des êtres humains dont la mémoire mérite le respect.
Nous, organisations humanitaires et de protection des droits humains, associations et citoyens, refusons l’indifférence et réclamons justice pour les disparus, dignité pour les vivants et l’accès aux voies légales et sûres pour mettre fin à ces tragédies.
Ces drames ne peuvent continuer de s’accumuler sans que soit questionnée la militarisation de cette frontière, via une surenchère de dispositifs de répression (kilomètres de barrières, barbelés, drones, multiples patrouilles de police, avion Frontex) ayant pour conséquence d’accroître les risques auxquels expose son franchissement. Nous soutenons les actions menées par les proches et familles des victimes devant les tribunaux afin que la vérité éclate sur le déroulement exact de cette nuit meurtrière, que soient identifiés tous les responsables et que justice soit faite. Nous exigeons une réforme profonde et urgente des politiques migratoires, fondées sur les principes d’humanité et le respect du droit international, en particulier l’obligation de porter secours aux passagers d’un bateau en difficulté et de débarquer les personnes dans un lieu sûr dans les meilleurs délais.
** **
Ce jeudi 23 janvier, se tenait la 8ᵉ édition de la “Nuit de la solidarité” organisée par la mairie de Paris.
Si cette action de la maire a pour objectif de “recenser” les personnes à la rue et d’“identifier leurs besoins”, elle n’aboutit à aucune solution de mise à l’abri, et se résume donc à une opération de communication. De plus, ce comptage ne prend pas en compte les personnes hébergées par les associations comme Utopia 56, ni celles qui, le temps d’une nuit, bénéficient d’une solution d’hébergement temporaire. La nuit de la Solidarité sous-estime et minimise le réel, et participe à l’invisibilisation des différents publics à la rue.
Pour sortir de l’invisibilité, les familles à la rue que nous accompagnons se sont rassemblées sur le parvis de la mairie du 19ᵉ arrondissement, afin d’être comptabilisées et de demander une mise à l’abri pérenne et digne.
Près de 150 personnes en familles et des soutiens étaient présents, plusieurs députés et journalistes nous ont rejoints dans la soirée. À quelques pas, le lycée Georges Brassens, vide et inutilisé, aurait pu être ouvert pour héberger toutes ces personnes. Ce dernier fait partie d’un ensemble de cinq lycées fermés définitivement, pour lesquels le 23 novembre 2023, la Région Île-de-France donnait son accord au Préfet de région en vue de la réquisition et la transformation en centres d’hébergement d’urgence de ces locaux. C’était il y a plus d’un an. Depuis, seuls trois d’entre eux ont permis d’assurer l’accueil de familles sans-abris.
Dès l’arrivée des premières familles devant la mairie du 19ᵉ, cinq camions de CRS ont été envoyés par la préfecture et les agents ont nassé le rassemblement (bien que cette technique soit annulée par le Conseil d’État depuis juin 2021). Beaucoup d’enfants étaient présents, des bébés de moins de 10 mois parfois, dans les bras ou dans les poussettes, mais aussi des enfants de 7-8 ans qui étaient à l’école quelques heures plus tôt.
Les familles passeront toute la nuit dehors, sur ce bout de trottoir, d’abord sous la menace si elles ne se dispersaient pas, puis dans l’attente d’une mise à l’abri. Il faisait 2°C. Des bénévoles d’Utopia 56 se sont relayés jusqu’au lendemain midi pour soutenir les familles et procéder à des distributions de couvertures (autorisées par la police uniquement pour les enfants), d’eau, et pour faire le lien entre les différents acteurs.
Parmi les profils des familles, nombre sont ceux rentrant dans le champ de compétence de la mairie de Paris, et sont donc sous sa responsabilité en matière d’hébergement d’urgence. Ce sont notamment les femmes enceintes ou encore les familles avec des enfants de moins de trois ans. Les autres personnes dépendent en théorie, elles, des services de l’État.
Pourtant, les deux acteurs se renvoient constamment la responsabilité. Pour cette fois, la mairie de Paris a finalement organisé une mise à l’abri pour une centaine de personnes toujours sur place le vendredi midi.
Toutefois, rien n’a été proposé pour les familles absentes, car parties à des rendez-vous, au travail, à l’école, où dans des accueils de jour se reposer quelques heures.
Le soir même, lors de notre permanence pour les familles à a rue, nous rencontrions 89 personnes, dont 37 enfants, en demande d’hébergement. La majorité d’entre elles étaient présentes au rassemblement de la veille, mais ont raté la mise à l’abri, ou sont arrivées trop tard et n’ont pas pu monter dans les bus. Nous avons pu trouver des solutions pour toutes ce soir-là grâce à notre réseau solidaire.
À Paris comme ailleurs, il existe des réponses : on compte 3,1 millions de logements vides en France (dont 416 000 en Ile-de-France), et 9 millions de m2 de bureaux vacants (dont 5 millions en Île-de-France). Les lois pour réquisitionner ces espaces existent déjà, il ne reste qu’à décider de les appliquer.
** **
Mineure, isolée et à la rue.
En moins d’une semaine, deux jeunes filles de 14 et 16 ans, ont été mises à la rue par le département à Tours, après s’être vues contester leur minorité, et cela, malgré des papiers d’identité prouvant leur âge.
Cette situation est loin d’être isolée. À Paris, nous avons déjà rencontré 24 jeunes filles remises à la rue par la ville depuis le début de l’année, contre 10 en janvier 2024.
Le nombre de jeunes filles abandonnées par les départements, suite à des évaluations sommaires, ne cesse d’augmenter depuis l’année dernière. Les équipes de Lille ont rencontré près du double de jeunes filles mise à la rue en 2024 par rapport à 2023 (26 en 2024, contre 15 en 2023).
Pour la seule ville de Paris, c’est 127 mineures isolées qui ont été rencontrées à la sortie de la cellule d’évaluation l’année dernière, contre 33 en 2023. Ce gros écart pour la capitale s’explique par le fait que jusqu’en juillet 2023, la ville de Paris maintenait l’hébergement inconditionnel pour les filles, et ce, même durant leur recours. Ce n’est plus le cas actuellement.
Ces jeunes mineures non accompagnées arrivent souvent en France après un parcours migratoire lourd et traumatisant. Comme pour les garçons, elles doivent passer une évaluation de la minorité afin d’obtenir le statut de mineure et ainsi être protégées et accompagnées par les dispositifs de la protection de l’enfance. Ces évaluations sont généralement très arbitraires et les décisions se basent sur des raisons subjectives comme “son attitude en entretien” ou “son physique”.
On peut notamment lire sur les papiers de refus :
- “considérant que le document d’identité et/ou le document d’état civil qui pourrait constituer un justificatif de votre minorité semble susceptible de ne pas être conforme”, pour contrecarrer la présentation d’un passeport.
- “considérant que le récit comporte des approximations susceptibles de mettre en cause son authenticité”, lorsqu’on reproche à la jeune ses hésitations qui prouveraient qu’elle invente. Tout comme l’argument inverse existe aussi, si le récit est très détaillé, trop précis, la jeune peut être accusée de l’avoir appris par cœur.
- “considérant que le physique est en décalage avec l’âge déclaré”, alors même qu’il est bien demandé aux évaluateurs de ne pas se fier qu’au physique des jeunes.
Beaucoup ne sont alors pas administrativement reconnues mineures et sont remises dehors, leur vulnérabilité est mise de côté et n’est pas considérée. À la suite de cette évaluation, les départements se dédouanent de toutes responsabilités, alors même qu’ils mettent en péril ces jeunes filles, en les laissant en proie aux dangers de la rue.
La semaine dernière, Carla*, 16 ans, était remise à la rue par la ville de Paris alors même que sa vulnérabilité psychologique et ses pensées suicidaires étaient connues des équipes d’évaluation. Ils ont estimé qu’elle n’était pas mineure et l’ont donc laissé dehors avec un seul document : l’adresse des urgences psychiatriques. C’est quatre jours plus tard, après plusieurs de nos alertes, que la mairie de Paris a répondu et lui a trouvé une place en urgence pour la sortir de la rue. Durant le weekend, Carla* nous a envoyé plusieurs messages inquiétants et a disparu pendant plusieurs heures.
Du fait de leurs multiples statuts – fille, enfant, en situation d’exil – les jeunes filles isolées se heurtent à beaucoup plus de risques. Les mettre à l’abri est une priorité pour leur éviter de passer même une seule nuit dehors. En plus des dangers liés à la rue, il y a le risque des réseaux de traite d’êtres humains ou de prostitution, il suffit de quelques heures dehors pour perdre tout contact.
Parfois ça ne suffit pas. À Rennes, Hawa*, 16 ans, a été mise à la rue par le département jeudi 23 janvier. Elle a pu être accueillie par une hébergeuse de notre réseau solidaire le soir même, mais elle a disparu le lendemain dans la journée. Malgré nos différentes alertes, nous n’avons pas de nouvelles à ce jour. Ce n’est malheureusement pas la première jeune que nous suivons qui disparait ainsi.
Les jeunes mineur⸱es, filles ou garçons, peuvent contester la décision du département en saisissant le juge des enfants, mais le recours dure des mois et en attendant, aucune solution d’hébergement ne leur est proposée. Pourtant, environ 75% des jeunes filles que nous avons accompagnées dans leur recours, ont finalement été reconnues mineures et ont réintégré les services de protection de l’enfance.
Si pour l’instant, nous arrivons encore à trouver des solutions pour leur proposer un toit à toutes, grâce à nos réseaux d’hébergeur⸱euses solidaires, nous allons manquer de ressources et de solutions.
À nouveau, les associations et citoyen⸱nes solidaires pallient les manquements des départements et de l’État dans le système d’accueil, mais jusqu’à quand.
*les prénoms ont été changés.
** **
Utopia 56 visée par trois procédures judiciaires
Ces derniers jours, et à l’initiative de l’association, le jounal Le Monde a relayé les enquêtes qui visent actuellement des bénévoles d’Utopia 56.
La première porte sur des faits de diffamation à l’encontre des forces de l’ordre à raison de propos publiés sur X (anciennement Twitter), faisant état d’un bateau incendié.
Pour les deux autres, il est reproché aux bénévoles de l’association d’avoir intentionnellement alerté les secours de situations fausses, ce qui les aurait mobilisés ou aurait été susceptible de les mobiliser de manière injustifiée.
En août 2023, une équipe d’Utopia 56 appelait les secours pour signaler une situation de détresse en mer. La bénévole mise en cause se voit reprocher d’avoir communiqué une fausse alerte aux secours, et ce, dans l’objectif de les détourner d’autres situations nécessitant leur présence, mettant ainsi la vie d’autrui en danger.
En août 2024, un bénévole appelait les secours pour signaler une suspicion de décès d’un enfant qui lui avait été communiquée, indiquant très clairement qu’il ne pouvait rien affirmer et ne faisait que relayer des témoignages reçus de personnes paniquées.
Utopia 56 nie toute instrumentalisation des appels aux secours par ses bénévoles, qui sont susceptibles de se retrouver, comme cela arrive malheureusement trop souvent, face à des situations pouvant nécessiter des soins médicaux et l’intervention des secours. N’étant ni professionnels de santé, ni spécifiquement formés à des situations d’urgence médicale, il est naturel qu’ils laissent aux secours la décision d’intervenir ou non.
L’ouverture d’enquêtes préliminaires sur la base de telles qualifications porte à croire que ces appels visaient, intentionnellement et de manière tout à fait inconséquente, à détourner les services de secours d’autres situations réelles de détresse, ce qui ne correspond ni à la réalité de ces deux incidents, ni aux voies de communication que l’association tente de construire avec les forces de l’ordre et les pompiers.
En effet, l’association a pour objectif de discuter et d’améliorer ses prises de contact avec les secours et les forces de l’ordre pour simplifier la transmission d’informations. À ce jour, nos demandes de rendez-vous sont restées lettres mortes.
Naturellement, Utopia 56 se tient à disposition de la justice dans chacune des trois procédures.
Accompagnés par nos avocats, nous répondrons à toutes les questions posées par les enquêteurs et apporterons les éléments factuels démontrant que notre travail est réalisé de bonne foi, dans le respect du cadre légal et dans l’objectif de la sauvegarde de la vie humaine.
Cette situation est sans précédent pour l’association qui se plie à déployer des actions d’intervention humanitaire à destination des personnes en situation de détresse dans sept villes en France.
Sur le littoral nord, il convient de rappeler qu’Utopia 56 a reçu, en 2024, 384 appels de détresse en mer impliquant plus de 13 400 personnes et que nos équipes sont intervenues auprès d’environ 14 000 personnes, trempées, traumatisées, voire blessées, après des tentatives de traversées de la Manche.
Sur ce même littoral, nous avons effectué près de 20 signalements à l’IGPN et 37 saisines auprès du service Déontologie de la Défenseure des droits, car nous croyons qu’en tout lieu, et en tout temps, le respect du cadre légal, dans la gestion de situations humanitaires tendues est primordial. Nous nous saisissons donc des moyens mis à disposition pour permettre que le droit continue d’être respecté.
De même, il est important de souligner que nos équipes sont appelées à l’aide quotidiennement par des services de sécurité et de secours – gendarmerie, police et secours – souvent débordés par la gravité de la situation humanitaire qui se déroule sur le littoral et dont les personnes qui tentent la traversée dangereuse de la Manche sont les premières victimes.
Enfin, il est tragique de rappeler qu’au moins 80 personnes ont perdu la vie à cette frontière depuis le début de l’année. Un chiffre supérieur au total cumulé des cinq dernières années. Sans l’intervention des associations présentes sur le littoral, de nombreux décès supplémentaires seraient à déplorer. C’est pourquoi, malgré les obstacles que représentent ces enquêtes préliminaires, les équipes d’Utopia 56 continueront à intervenir sur le terrain, jour et nuit, pour fournir une aide humanitaire et dénoncer la violence des politiques migratoires.
Si nous avons souhaité rendre publiques ces enquêtes par l’intermédiaire de la presse, c’est par souci de transparence, mais aussi pour alerter sur ce qu’il nous paraît être le prolongement d’une volonté d’intimidation à l’encontre de nos équipes et d’entrave à notre mission.
À titre d’exemple, depuis le début de l’année, nos équipes du nord ont subi 98 contrôles de police et nos véhicules ont été fouillés à 59 reprises, sans qu’aucune infraction ne soit finalement constatée.
Utopia 56, dans toutes ses antennes, continuera à distribuer des milliers de repas, de vêtements, de couvertures, de tentes, et à proposer près de 40 000 nuitées d’hébergement pour que les personnes en détresse puissent bénéficier d’un peu de répit.
Utopia56.org
