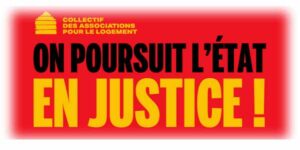
Quelques faits incontournables
L’évocation « d’Oradours » durant la conquête de l’Algérie par Jean-Michel Aphatie a suscité des réactions indignées qui témoignent d’un déni persistant des connaissances historiques.
Les déclarations du journaliste Jean-Michel Apathie sur les « nombreux Oradours » commis par l’armée française lors de la conquête de l’Algérie, ont suscité une avalanche de protestations indignées. Leur thème dominant fut : des soldats français ne pouvaient pas avoir fait cela.
Ces protestations ignorent l’histoire concrète de nombreux épisodes des guerres coloniales, de la conquête de l’Algérie à celle de l’Indochine, en passant par les raids sur des villages africains ou les massacres de kanak, une histoire documentée depuis des lustres par une quantité imposante de témoignages et de traces écrites. Elles partent du principe qu’il y aurait une nature intrinsèque de l’être humain français sous l’uniforme qui rendrait impossible que de tels faits pourtant parfaitement établis aient pu être commis.
Aucune de ces protestations ne s’est appuyée sur la documentation existante, notamment sur l’abondante correspondance des généraux de la conquête de l’Algérie, dont Bugeaud, qui ont décrit par le menu de tels actes.
La parution récente de l’ouvrage d’Alain Ruscio, qui porte précisément sur la période de cette « première guerre d’Algérie », permet cependant d’affirmer qu’il y eut maints et maints assauts de villages qui se sont achevés dans le sang, parfois, par l’extermination de populations entières.
Nous présentons ici quelques pages issues de cet ouvrage, décrivant des destructions totales de lieux et des élimination physiques de masse. Comparaison n’est pas raison : mais comment ne pas penser à Oradour ?
Histoire coloniale et postcoloniale
*-*
Le duc de Rovigo et le massacre de la tribu des El Ouffia, avril 1832
Les dix-huit mois de la présence française virent défiler trois commandants en chefs, remerciéspour des raisons variées. Le quatrième fut un homme à poigne : Anne Jean-Marie René Savary, duc de Rovigo nommé le 6 décembre 1831. Sa nomination, en remplacement de Berthezène, jugé conciliateur par les colonistes, eut une signification évidente : seule la manière forte pouvait mettre les indigènes à la raison. Car Rovigo avait une longue carrière, connue de tous, aux côtés de Bonaparte, souvent faite de brutalités et d’exactions à l’extérieur (Égypte 1798-1799, Espagne 1808) et à l’intérieur (il avait été ministre de la Police de 1810 à 1814, se distinguant par son « mépris des garanties légales et de la vie humaine »). À son âge, 57 ans à ce moment, il n’allait pas changer ses « habitudes impériales » (Amédée Desjobert).
La population algérienne devait vite subir ces « habitudes ». C’est sous son mandat qu’éclata la plus grave affaire des cimetières détruits et des ossements dispersés (voir chapitre 20).
Les morts furent donc profanés… et les vivants furent assassinés.
La terrible affaire du massacre de la tribu d’El Ouffia, installée à El Harrach, débuta comme un banal fait divers. Des émissaires d’un caïd* du Constantinois, Ferhat ben Saïd, surnommé « le grand serpent du désert », allié des Français, furent interceptés et dépouillés par des maraudeurs, non loin de Maison-Carrée, à dix kilomètres d’Alger, sur un territoire où vivait la tribu d’El Ouffia, celle-ci n’ayant en rien participé au vol. Malgré cela, une expédition punitive fut immédiatement décidée. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1832, une colonne, entre 600 et 800 hommes, selon les sources, fondit sur le village au petit jour. Les habitants, écrivit Pellissier de Reynaud, furent égorgés, « sans que ces malheureux cherchassent même à se défendre. Tout ce qui vivait fut voué à la mort ; tout ce qui pouvait être pris fut enlevé ; on ne fit aucune distinction d’âge ni de sexe ». Seuls furent épargnés « quelques femmes et quelques enfants », par « l’humanité d’un petit nombre d’officiers. » Furent également épargnés – provisoirement – deux chefs de la tribu, Rahbia ben sidi Grahnem, appelé par les textes postérieurs El Rabbia, et Bourachba, en vue de faire un exemple marquant les esprits (voir infra).
La plupart des récits estiment qu’il y eut entre 80 et 100 morts. Si ces chiffres sont fondés, cela signifie qu’il y eut entre six et huit assaillants pour un habitant tué.
Le raid avait été rapide. Dès l’après-midi, la troupe revint. Certains soldats français arboraient fièrement des têtes piquées sur leurs lances. Afin de doubler cette répression, une opération visant à terrifier la population algéroise, le reste du butin – « des bracelets de femmes qui entouraient encore des poignets coupés et des boucles d’oreilles pendant à des lambeaux de chair » fut exposé au marché de Bab-Azoun. Enfin, pour célébrer cette « grande victoire », le commissaire de police de la ville d’Alger ordonna à la population indigène d’illuminer la ville « en signe de réjouissance. »
Or, entre temps, les vrais coupables, appartenant à la tribu toute différente des Krechnas, avaient été découverts et avaient même rendu le produit du larcin. Se produisit alors un épisode qui ajouta le sordide au criminel. Que faire des deux chefs de la tribu ramenés à Alger, évidemment innocents, dès lors que la responsabilité de leur tribu était de façon publique écartée ? Le baron Louis-André Pichon, intendant civil, plaida pour la relaxe. Ce à quoi Rovigo répondit d’une formule qui en dit long sur l’état d’esprit de bien des officiers de l’époque : « Je n’ai pas d’autre justice que la justice militaire (…), il vaudrait mieux n’en avoir pas du tout que de traiter ces peuples-ci avec les ménagements qui suffisent pour gouverner ceux de notre pays. » Selon cette logique implacable, quatre condamnations à mort pour « crime d’embauchage » et « trahison envers la France » furent prononcées, dont deux par contumace (14 avril). Rovigo bafoua même la propre loi des Français, qui ne prévoyait d’exécutions capitales que lorsque des Français avaient été victimes (arrêté Clauzel, 15 octobre 1830, article 1er). L’appel fut rejeté (17 avril). Deux sentences furent donc appliquées. Les condamnés furent exécutés en public le 19 avril, à Bab Azoum. Ce fut, affirma l’historien Dieuzaide, un « assassinat juridique ». Entre le début du drame et ces exécutions, il s’était passé deux semaines.
Après l’injustice, les coups bas. Le commandant en chef, outré qu’un civil ait osé remettre en cause son autorité, obtint rapidement le rappel du baron Pichon (d’autant qu’un accrochage sur une question politique d’importance, l’accélération ou non de la colonisation des terres, les avait déjà opposés. Voir chapitre 13). Le 10 mai 1832, un mois après les exécutions, Pichon fut remplacé par Pierre Genty de Bussy (1795-1867). Le 12 mai, une ordonnance royale accorda à Rovigo la prééminence totale, désormais, sur les autorités civiles.
Rovigo, se débarrassant d’un opposant à Alger, envoya en fait un ennemi tenace à Paris. Pichon se révéla redoutable, contactant divers milieux, donnant des détails sur le forfait. Devant le scandale, une commission d’enquête fut dépêchée et fournit en juillet 1833 un rapport accablant : l’attitude du commandant en chef fut jugée « en contradiction non seulement avec la justice, mais avec la raison ». Le rapport final dénonçait le drame d’El Ouffia :
« Nous avons envoyé au supplice, sur un simple soupçon et sans procès, des gens dont la culpabilité est restée plus que douteuse depuis. […] Nous avons égorgé, sur un soupçon, des populations entières qui se sont ensuite trouvées innocentes. »
Le duc de Rovigo ne fut pour cela être inquiété. Et pour cause : le 4 mars précédent, il avait quitté l’Algérie, suite à un mal de gorge persistant qui se révéla être un cancer du larynx. Arrivé à Paris le 30 mars, il fut jugé par les médecins inopérable. Il mourut le 2 juin 1833, un mois avant la publication de ce rapport.
Un fait, pourtant, ne fut pas relevé par la presse. Trois semaines après le massacre, une colonne de la Légion étrangère fut attaquée et anéantie dans la même région. Cette colonne avait participé à ce massacre, et tout laisse à penser qu’elle fut ciblée pour cette raison. Christian Pitois (1811-1877), historien de la colonisation (qui signait P. Christian) ne put que constater, désolé : « Le duc de Rovigo ne savait que nous faire haïr et mépriser. »
Mais la mémoire coloniale n’eut pas cette sévérité : en 1846, un village de colonisation, à moins de 30 km d’El Ouffia, reçut le nom de Rovigo. Le nom du duc est honoré sur l’un des piliers de l’Arc-de-Triomphe.
L’enfumade de Dahra, juin 1845
Enfumer : contraindre des populations à se réfugier dans des endroits isolés, en l’occurrence des grottes, puis les brûler et / ou les asphyxier. Cette forme de répression fut, quantitativement, une goutte d’eau dans l’océan des victimes de la période étudiée. Mais son caractère particulièrement macabre, puis, surtout, l’éclatement du scandale en métropole, ont grandement contribué à en faire un symbole de l’inhumanité de cette guerre.
Celle des grottes du Dahra est passée à la postérité par les révélations qui furent faites quasi immédiatement et portées à la connaissance du public. La répression n’avait pas mis fin à l’agitation dans l’ouest algérien. Il fallait en finir.
Le général Aimable Pélissier, commandant de la subdivision de Mostaganem, était à la poursuite des tribus insurgées. Il avait correspondu avec Bugeaud, alors en poste à Orléansville, après avoir lui-même guerroyé. C’est de ce poste que Bugeaud adressa à son subordonné une phrase terrifiante : « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Sbeahs ; fumez-les à outrance, comme des renards » (11 juin). En possession de ce blanc-seing, Pélissier passa à l’acte. Sa colonne possédait une supériorité écrasante : 2 254 soldats bien armés, disciplinés, encadrés, face à une à deux centaines d’hommes dont le seul avantage était la connaissance du terrain (ils n’appartenaient pas aux troupes régulières d’Abd el-Kader, ils étaient plutôt des francs-tireurs) armés de fusils de chasse ou d’armes récupérées auprès des Français.
Le drame se déroula sur trois jours, les 18, 19 et 20 juin 1845. La colonne avait été harcelée par des tireurs isolés. Elle fit le vide devant elle en brûlant habitations, récoltes, champs et vergers de la région. Face à cette avancée, les combattants et les populations (leurs familles) se replièrent vers les grottes du Frechich, qu’ils connaissaient bien. Pélissier chargea un interprète de leur faire savoir qu’ils risquaient la mort par l’incendie ou l’asphyxie. Cinquante-six mules chargées de produits combustibles accompagnaient la troupe. Le reste, pour alimenter le feu, fut fourni par les fascines (fagots faits avec les broussailles environnantes). Les négociations échouèrent : Pélissier demandait une reddition pure et simple. Quelques coups de feu furent échangés. Malice, couverture (dans la crainte d’une éventuelle divulgation de l’acte) ou strict sens de la discipline, Pélissier ponctuait son récit d’une référence aux ordres de Bugeaud :
« Je n’eus plus qu’à suivre la marche que vous m’aviez indiquée, je fis faire une masse de fagots et après beaucoup d’efforts un foyer fut allumé et entretenu à l’entrée supérieure. […] À trois heures, l’incendie commença sur tous les points et jusqu’à une heure avant le jour le feu fut entretenu tant bien que mal afin de bien saisir ceux qui pourraient tenter de se soustraire par la fuite à la soumission ».
Cette précision permet d’affirmer que le feu intense dura de l’ordre de 14 à 15 heures (de 3 heures de l’après-midi à 5 ou 6 heures du matin – « une heure avant le jour »). Pélissier rendait également compte des armes saisies : 60 fusils, une douzaine de sabres, quelques pistolets et quelques lames de baïonnettes françaises. Rappelons que la colonne Pélissier comptait 2 254 hommes armés, donc autant de fusils, plus des pièces d’artillerie.
On imagine que, comme celle de Cavaignac l’année précédente, les autorités auraient volontiers masqué à l’opinion l’enfumade du Dahra. Mais deux témoignages fuitèrent. Le premier fut le rapport Pélissier lui-même : envoyé d’abord à Alger, il fut immédiatement transmis à Paris. Canrobert, candide, donna l’explication : « Si le maréchal Bugeaud avait été à Alger, il eût arrêté le rapport ; mais il était en expédition. » Mais il y avait une faille plus importante encore dans la volonté de masquer le drame : Pélissier avait eu la maladresse d’accepter un observateur étranger, un officier espagnol, non nommé dans les sources, qui assista à la scène et envoya son témoignage au quotidien madrilène, très lu, Heraldo. Ce texte, repris par la presse française à partir du 12 juillet, devint le support de l’accusation. L’officier fit partie du premier groupe, une soixantaine d’hommes, qui pénétra dans les grottes après le drame :
« À l’entrée se trouvaient des animaux morts, déjà on putréfaction, et enveloppés de couvertures de laine qui brûlaient encore. On arrivait à la porte par une traînée de cendre et de poussière d’un pied de haut, et de là nous pénétrâmes dans une grande cavité de trente pas environ. Rien ne pourrait donner une idée de l’horrible spectacle que présentait la caverne. Tous les cadavres étaient nus, dans des positions qui indiquaient les convulsions qu’ils avaient dû éprouver avant d’expirer. Le sang leur sortait par la bouche. Mais ce qui causait le plus d’horreur, c’était de voir des enfants à la mamelle gisant au milieu des débris de moutons des sacs de fèves, etc. On voyait aussi des vases de terre qui avaient contenu de l’eau, des caisses, des papiers et un grand nombre d’effets. »
Les odeurs pestilentielles étaient si insupportables, précisa-t-il encore, que les soldats durent se déplacer « d’une demi-lieue » (de l’ordre de 2 kilomètres) pour pouvoir respirer normalement. Le terrain était libre pour « les corbeaux et les vautours […] que, de notre campement, nous voyions emporter d’énormes débris humains ».
Au total, combien y eut-il de victimes ? On peut imaginer qu’en ces temps de mépris pour les indigènes, l’état-major de la colonne ne prit guère le temps de compter précisément les cadavres : l’acte accompli, la troupe repartit. Pélissier, dans son rapport, avança une estimation : « plus de cinq cents ». L’officier espagnol contesta ce chiffre : « Le nombre des cadavres s’élevait de 800 à 1 000 ». Une étude ultérieure confirme une fourchette haute : « entre 700 et 1 200 personnes ».
Cet épouvantable drame fut l’occasion d’une polémique, probablement la plus intense de toute la première guerre d’Algérie. Dès le 11 juillet, un débat, vif, se déroula à la Chambre des Pairs. Un ancien officier de l’armée d’Afrique, Napoléon-Joseph Ney, second prince de la Moskowa (1803-1857), fils du célèbre maréchal, qualifia cet épisode de « récit inouï, sans exemple et heureusement sans précédent dans notre histoire militaire » (ce « sans précédent » était quelque peu aventureux). Il fustigea « un colonel » (non nommé) pour avoir commis un acte « d’une cruauté inexplicable, inqualifiable ». Le prince employa la formule la plus adéquate : il s’était agi d’un « meurtre consommé avec préméditation sur des Arabes réfugiés sans défense ». Le maréchal Soult répondit avec embarras, au milieu de protestations : « Pour le fait lui-même, le Gouvernement le désapprouve hautement », mais tempéra cette désapprobation par la pénurie de renseignements – ce qui était un mensonge, il était en possession d’un rapport détaillé de Bugeaud depuis le 25 juin. Soult fut ensuite apostrophé par le comte de Montalembert (1810-1870) : « Le mot de désapprouver dont vient de se servir monsieur le maréchal est trop faible pour un attentat pareil ». Soult reprit alors la parole : « Si l’expression de désapprobation que j’ai employée au sujet du fait dont il est question est insuffisante, j’ajoute que je le déplore ».
Contrairement à d’autres exactions contemporaines, la presse rendit compte avec précision – et effroi – de cette enfumade. La société française fut un temps secouée. L’Algérie, courrier d’Afrique, périodique publié en métropole, dénonça la mort de « cinq cents martyrs », La Réforme évoqua « l’acte de barbarie le plus atroce dont l’histoire fasse mention », Le Nationalfit un parallèle (audacieux) avec les officiers d’antan qui n’auraient jamais procédé de la sorte, Le Courrier français dit que cette « grillade » avait été « commise de sang-froid, et sans nécessité », etc. Christian Pitois, qui avait été peu de temps auparavant secrétaire particulier de Bugeaud, se brouilla avec lui et publia un ouvrage décrivant entre autres le drame, avec une gravure due à l’illustrateur renommé Tony Joannot (1803-1852). Plus tard, Victor Hugo, pour illustrer la « férocité » de l’armée française en Algérie, donna comme exemple « Colonel Pélissier, les Arabes fumés vifs » (15 octobre 1852). Outre Pélissier, la principale cible de la protestation fut, logiquement, Bugeaud. Le Charivari, journal satirique d’opposition, s’en prit à « M. Bugeaud, l’ordonnateur des brûleries du Dahra » (27 juillet), responsable de « cet horrible événement du Dahra, qui est comme la rue Transnonain de l’Afrique » (28 juillet).
La suite :
https://histoirecoloniale.net/y-eut-il-des-oradour-algeriens-durant-la-conquete-quelqu
