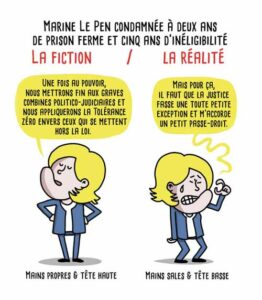
J’ai une déclaration à faire
Le gouvernement de mon pays, la Hongrie, est – avec le gouvernement provincial bavarois (provincial dans plus d’un sens) – le plus grand soutien étranger de l’Autriche de Jörg Haider. Le cabinet de droite de Budapest, entre autres méfaits, tente de supprimer la gouvernance parlementaire, pénalise les autorités locales d’une couleur politique différente de la sienne et s’emploie à créer et à imposer une nouvelle idéologie d’État, avec l’aide d’un certain nombre d’intellectuels d’extrême droite, y compris quelques néonazis déclarés. Il est de mèche avec un parti fasciste ouvertement et méchamment antisémite qui est, hélas, représenté au parlement. Des personnes travaillant pour le cabinet du premier ministre se livrent à un révisionnisme plus ou moins prudent de l’Holocauste. La télévision d’État contrôlée par le gouvernement laisse libre cours à un racisme anti-tsigane brutal. Les supporters du club de football le plus populaire du pays, dont le président est un ministre et un chef de parti, chantent à l’unisson à propos du train qui doit partir d’un moment à l’autre pour Auschwitz.
Partout dans le monde contemporain, il existe un fascisme post-totalitaire qui survit sans Führer, sans parti unique, sans SA ni SS
Au rez-de-chaussée de l’Université d’Europe centrale à Budapest, tu peux visiter une exposition concernant les années de troubles d’il y a une dizaine d’années. Tu peux y regarder une vidéo enregistrée illégalement en 1988, et tu peux y voir l’actuel premier ministre hongrois me défendre et me protéger avec son propre corps des matraques de la police antiémeute communiste. Dix ans plus tard, cette même personne a nommé un général de la police communiste comme ministre de l’intérieur, la deuxième ou troisième personne la plus importante du cabinet. Les conflits politiques entre anciens amis et alliés sont généralement acrimonieux. Celui-ci ne fait pas exception à la règle. Je participe activement à un mouvement antifasciste naissant en Hongrie, je prends la parole lors de rassemblements et de manifestations. Nos adversaires – en termes personnels – sont trop proches pour être à l’aise. Je ne peux donc pas me considérer comme un observateur neutre.
Le phénomène que j’appellerai post-fascisme n’est pas propre à l’Europe centrale. Loin de là. Bien sûr, l’Allemagne, l’Autriche et la Hongrie sont importantes, pour des raisons historiques évidentes pour tous ; des phrases familières répétées ici ont des échos différents. J’ai vu récemment que l’ancienne usine de briques du troisième arrondissement de Budapest était en train d’être démolie ; on m’a dit qu’ils allaient construire à sa place une communauté fermée de villas de banlieue. C’est dans cette briqueterie que les juifs de Budapest attendaient leur tour pour être transportés vers les camps de concentration. Vous pourriez tout aussi bien construire des maisons de vacances à Treblinka. Notre vigilance dans cette partie du monde est peut-être plus nécessaire qu’ailleurs, car l’innocence, en termes historiques, ne peut être présumée. Pourtant, le post-fascisme est un ensemble de politiques, de pratiques, de routines et d’idéologies que l’on peut observer partout dans le monde contemporain ; qui n’ont rien à voir ou presque, sauf en Europe centrale, avec l’héritage du nazisme ; qui ne sont pas totalitaires ; qui ne sont pas du tout révolutionnaires ; et qui ne sont pas fondées sur des mouvements de masse violents et des philosophies irrationalistes et volontaristes, ni ne jouent, même en plaisantant, avec l’anticapitalisme.
Pourquoi appeler ce groupe de phénomènes fascisme, même s’il s’agit d’un post-fascisme ?
Le post-fascisme trouve facilement sa place dans le nouveau monde du capitalisme mondial sans bouleverser les formes politiques dominantes de la démocratie électorale et du gouvernement représentatif. Il fait ce que je considère être au cœur de toutes les variétés de fascisme, y compris la version post-totalitaire. Sans Führer, sans parti unique, sans SA ou SS, le post-fascisme renverse la tendance des Lumières à assimiler la citoyenneté à la condition humaine.
Avant les Lumières, la citoyenneté était un privilège, un statut élevé limité par l’ascendance, la classe, la race, la croyance, le sexe, la participation politique, la morale, la profession, le patronage et le décret administratif, sans parler de l’âge et de l’éducation. L’appartenance active à la communauté politique était un poste auquel on aspirait, civis Romanus sum, l’énonciation d’une certaine noblesse. Les politiques d’extension de la citoyenneté pouvaient être généreuses ou avares, mais la règle était que le rang de citoyen était conféré par l’autorité légalement constituée, en fonction de l’opportunité. Le christianisme, comme certains stoïciens, a cherché à transcender ce type de citoyenneté limitée en la considérant de second ordre ou inessentielle par rapport à une communauté virtuelle de sauvés. La liberté du péché était supérieure à la liberté de la ville. Au cours de la longue obsolescence médiévale du civisme, la revendication d’une adhésion active à la communauté politique a été supplantée par les exigences d’une gouvernance juste, et l’excellence civique a été abrégée en vertu martiale.
Une fois la citoyenneté assimilée à la dignité humaine, son extension à toutes les classes, à toutes les professions, aux deux sexes, à toutes les races, à toutes les croyances et à tous les lieux n’était qu’une question de temps. Le droit de vote universel, le service national et l’éducation publique pour tous devaient suivre. De plus, une fois que tous les êtres humains étaient censés pouvoir accéder au rang élevé de citoyen, la solidarité nationale au sein de la communauté politique nouvellement égalitaire exigeait l’allègement du domaine de l’homme, une existence matérielle digne pour tous et l’éradication des vestiges de la servitude personnelle. L’État, censé représenter tout le monde, a été contraint d’accorder non seulement un minimum de richesse à la plupart des gens, mais aussi un minimum de loisirs, autrefois le fief temporel exclusif des seuls gentlemen, afin de nous permettre à tous de jouer et de profiter des bienfaits de la culture.
Le post-fascisme trouve facilement sa place dans le nouveau monde du capitalisme mondial sans bouleverser la démocratie électorale.
Pour les libéraux, les sociaux-démocrates et autres héritiers progressistes du siècle des Lumières, le progrès signifiait donc la citoyenneté universelle – c’est-à-dire une égalité virtuelle de la condition politique, un droit de parole virtuellement égal pour tous dans les affaires communes d’une communauté donnée – ainsi qu’une condition sociale et un modèle de rationalité qui pouvaient rendre cela possible. Pour certains, le socialisme semblait être la simple continuation et l’élargissement du projet des Lumières ; pour d’autres, comme Karl Marx, l’achèvement du projet nécessitait une révolution (supprimer l’appropriation de la plus-value et mettre fin à la division sociale du travail). Mais pour tous, il semblait assez évident que la fusion de la condition humaine et de la condition politique était, tout simplement, une nécessité morale.
Les condamnations sauvages de la société bourgeoise au 19e siècle – base commune, pendant un certain temps, de l’avant-garde culturelle et de la radicalité politique – découlaient de la conviction que le processus, tel qu’il était, était frauduleux et que la liberté individuelle n’était pas ce qu’elle était censée être, et non pas de l’opinion, représentée seulement par quelques figures solitaires, selon laquelle l’effort était sans valeur. Nietzsche et Dostoïevski n’étaient pas les seuls à craindre que l’augmentation de l’égalité ne transforme tous les membres des classes moyennes et inférieures en bourgeois philistins. Les révolutionnaires progressistes voulaient eux aussi un homme nouveau et une femme nouvelle, débarrassés des démons intérieurs de la répression et de la domination : une communauté civique qui était en même temps la communauté humaine avait besoin d’une nouvelle morale fondée sur le respect de ceux qui étaient jusqu’alors exclus.
Cette aventure s’est terminée par la débâcle de 1914. Le fascisme a offert la réponse la plus déterminée à l’effondrement des Lumières, en particulier du socialisme démocratique et de la réforme sociale progressiste. Dans l’ensemble, le fascisme n’était pas conservateur, même s’il était contre-révolutionnaire : il n’a pas rétabli l’aristocratie héréditaire ou la monarchie, malgré un certain verbiage romantico-réactionnaire. Mais il a réussi à défaire la notion clé de régulation (ou liminale) de la société moderne, celle de la citoyenneté universelle. À cette époque, on pensait que les gouvernements représentaient et protégeaient tout le monde. Les frontières nationales ou étatiques définissaient la différence entre l’ami et l’ennemi ; les étrangers pouvaient être des ennemis, mais pas les concitoyens. Selon Carl Schmitt, le théoricien juridique du fascisme et le théologien politique du Troisième Reich, le souverain ne pouvait pas simplement décider par décret qui serait l’ami et qui serait l’ennemi. Mais Schmitt avait raison sur un point fondamental : l’idée de citoyenneté universelle contient une contradiction inhérente dans la mesure où l’institution dominante de la société moderne, l’État-nation, est à la fois une institution universaliste et paroissiale (puisque territoriale). Le nationalisme libéral, contrairement à l’ethnicisme et au fascisme, est un universalisme limité – si tu veux, tempéré. Le fascisme a mis fin à ces tergiversations : le souverain est le juge de qui appartient ou n’appartient pas à la communauté civique, et la citoyenneté devient une fonction de son (ou de ses) décret(s) tranchant(s).
Cette hostilité à la citoyenneté universelle est, à mon avis, la principale caractéristique du fascisme. Et le rejet d’un universalisme même tempéré est ce que nous voyons maintenant se répéter dans des circonstances démocratiques (je ne dis même pas sous un déguisement démocratique). Le fascisme post-totalitaire prospère sous la carapace capacitive du capitalisme mondial, et nous devrions dire les choses telles qu’elles sont.
Il y a une logique dans la déclaration nazie selon laquelle les communistes, les juifs, les homosexuels et les malades mentaux sont des non-citoyens et, par conséquent, des non-humains. (Le célèbre idéologue de la Garde de fer, le suave essayiste E. M. Cioran, a fait remarquer à l’époque que si certaines personnes sont non humaines mais aspirent à l’humanité [c’est-à-dire les Juifs], la contradiction pourrait être sublimée et résolue par leur mort violente, de préférence, selon le célèbre esthète toujours à la mode, de leur propre main.)
Partout, de la Lituanie à la Californie, les minorités immigrées et même autochtones sont devenues l’ennemi
Ces catégories de personnes, telles que les voyaient les nazis, représentaient des types cruciaux pour le projet d’inclusion des Lumières. Les communistes représentaient le « type inférieur » rebelle, les masses amenées, sans chef et sans gouvernail, par un universalisme sans racines, puis se soulevant contre la hiérarchie naturelle ; les Juifs, une communauté qui a survécu au Moyen Âge chrétien sans pouvoir politique propre, dirigée par une autorité essentiellement non coercitive, le peuple du Livre, par définition pas un peuple de la guerre ; les homosexuels, par leur incapacité ou leur refus de procréer, de léguer et de continuer, réfutation vivante du prétendu lien entre nature et histoire ; les malades mentaux, à l’écoute de voix non entendues par le reste d’entre nous – autrement dit, des personnes dont la reconnaissance nécessite un effort moral et n’est pas immédiatement (« naturellement ») donnée, qui ne peuvent s’intégrer qu’en promulguant une égalité des inégaux.
La différenciation périlleuse entre citoyen et non-citoyen n’est pas, bien sûr, une invention fasciste. Comme le souligne Michael Mann dans une étude novatrice, l’expression classique « nous le peuple » n’incluait pas les esclaves noirs et les « Indiens rouges » (Amérindiens), et les définitions ethniques, régionales, de classe et confessionnelles du « peuple » ont conduit à des génocides à la fois « là-bas » (dans les colonies de peuplement) et à l’intérieur des États-nations (voir le massacre des Arméniens perpétré par les nationalistes turcs en voie de modernisation) sous des gouvernements démocratiques, semi-démocratiques ou autoritaires (mais pas « totalitaires »). Si la souveraineté est dévolue au peuple, la définition territoriale ou démographique de ce qu’est le peuple et de qui il est devient décisive. De plus, le retrait de la légitimité des régimes socialistes d’État (communistes) et nationalistes révolutionnaires (« tiers-monde »), avec leurs définitions factices de la nation, n’a laissé que des bases raciales, ethniques et confessionnelles pour une revendication légitime ou un titre de « formation de l’État » (comme en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie, dans l’ex-Union soviétique, en Éthiopie-Érythrée, au Soudan, etc.)
Partout, donc, de la Lituanie à la Californie, les minorités immigrées et même autochtones sont devenues l’ennemi et doivent supporter la diminution et la suspension de leurs droits civiques et humains. La propension de l’Union européenne à affaiblir l’État-nation et à renforcer le régionalisme (ce qui, par extension, pourrait renforcer le pouvoir du centre à Bruxelles et à Strasbourg) parvient à ethniciser la rivalité et l’inégalité territoriale (voir Italie du Nord contre Italie du Sud, Catalogne contre Andalousie, Sud-Est anglais contre Écosse, Belgique flamande contre Belgique wallonne, Bretagne contre Normandie). Les conflits de classe sont eux aussi ethnicisés et racialisés, entre la classe ouvrière et la classe moyenne inférieure de la métropole, bien établies et sûres, et les nouveaux immigrés de la périphérie, ce qui est également interprété comme un problème de sécurité et de criminalité. Les ethnicistes hongrois et serbes prétendent que la nation se trouve là où les personnes d’origine hongroise ou serbe vivent, quelle que soit leur citoyenneté, avec pour corollaire que les citoyens de leur État-nation qui sont ethniquement, racialement, confessionnellement ou culturellement « étrangers » n’appartiennent pas vraiment à la nation.
La dépolitisation croissante du concept de nation (le passage à une définition culturelle) conduit à accepter la discrimination comme « naturelle. » C’est le discours que la droite entonne ouvertement dans les parlements et les rassemblements de rue en Europe centrale et orientale, en Asie et, de plus en plus, en « Occident ». On ne peut nier que les attaques contre les systèmes d’aide sociale égalitaires et les techniques de discrimination positive ont partout un sombre sous-entendu racial, accompagné de brutalités policières racistes et d’actes d’auto-défense dans de nombreux endroits. Le lien, autrefois considéré comme nécessaire et logique, entre la citoyenneté, l’égalité et le territoire peut disparaître dans ce que le théoricien de la troisième voie, le sociologue anciennement marxisant Anthony Giddens, appelle une société de preneurs de risques responsables.
La tentative la plus profonde d’analyse du phénomène de l’exclusion politique est « La structure psychologique du fascisme » de Georges Bataille, qui s’appuie sur la distinction de l’auteur entre l’homogénéité et l’hétérogénéité. Pour simplifier, la société homogène est celle du travail, de l’échange, de l’utilité, de la répression sexuelle, de l’équité, de la tranquillité, de la procréation ; ce qui est hétérogène comprend tout ce qui résulte d’une dépense improductive (les choses sacrées elles-mêmes font partie de cet ensemble). Il s’agit de tout ce que la société homogène rejette comme déchets ou comme valeurs transcendantes supérieures. On y trouve les déchets du corps humain et de certaines matières analogues (ordures, vermine, etc.) ; les parties du corps ; les personnes, les paroles ou les actes ayant une valeur érotique suggestive ; les divers processus inconscients tels que les rêves et les névroses ; les nombreux éléments ou formes sociales ultérieurs que la société homogène est impuissante à assimiler (les foules, les classes guerrières, aristocratiques et paupérisées, les différents types d’individus violents ou du moins ceux qui refusent la règle – les meneurs, les chefs, les poètes, etc.) :
La violence, l’excès, le délire, la folie caractérisent les éléments hétérogènes […] par rapport à la vie quotidienne, l’existence hétérogène peut être représentée comme autre, comme incommensurable, en chargeant ces mots de la valeur positive qu’ils ont dans l’expérience affective.
Le pouvoir souverain, selon Bataille (et Carl Schmitt), est quintessentiellement hétérogène dans ses versions sacrées prémodernes (rois régnant de droit divin). Cette hétérogénéité est cachée dans la démocratie capitaliste, où le souverain est censé régner grâce à un ordre juridique impersonnel qui s’applique également à tous. La dictature fasciste a pour mission de la découvrir ou de la démasquer. C’est ce qui explique le lien de la dictature fasciste avec la foule appauvrie, désordonnée et lumpen. Et c’est exactement, devrais-je ajouter, ce qui se perd dans le post-fascisme. La recréation de la souveraineté sacrale par le fascisme est cependant factice. C’est l’homogénéité qui se fait passer pour de l’hétérogénéité. Ce qui reste dans la sphère homogène du milieu, c’est le pur bourgeois sans le citoyen, Julien Sorel enfin et définitivement dépouillé de son Napoléon, Lucien Leuwen privé de son Danton. Le fascisme, ayant mis fin à la réalisation bourgeoise des Lumières (c’est-à-dire à la démocratie capitaliste égalitaire), transforme l’exclusion sociale des improductifs (des ermites et des poètes vatiques aux indigents inemployables et aux rebelles indomptables) en leur exclusion naturelle (c’est-à-dire l’arrestation extra-légale, la faim et la mort).
Si la politique civique ne peut pas fournir la base de l’altruisme, le sentiment racial ou les sentiments de proximité culturelle le feront certainement.
…
Pour lire le document complet de Gaspar Miklos Tamás :
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/wp-content/uplo
A partir de la page 36
Du même l’auteur :
Il y a dix ans Gaspar Miklos Tamas décrit le Post-fascisme tel qu’il apparait dans la Hongrie de ORBAN
Dans le même document pdf ; à partir de la page 27
