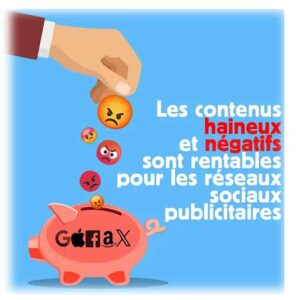
Je ne me souvenais pas qu’à propos du Vietnam, on avait aussi parlé de génocide
C’est que, dans la mémoire historique, la guerre du Vietnam ne se retrouve pas dans la liste des génocides estampillés au XXe siècle, avec celui des Hereros et des Namas en Namibie, des Arméniens de Turquie, des Juifs d’Europe, des Tutsis du Rwanda…
Tous ces génocides se rapprochent du « modèle Auschwitz » qui s’est imposé dans la perception la plus courante comme la forme exclusive du génocide. Dans chacun des cas cités, il s’agissait de faire totalement disparaître un groupe humain de la terre et d’en planifier l’extermination afin que personne n’en réchappe. Pourtant, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, votée par l’Assemblée générale des Nations-Unies le 9 décembre 1948, propose une définition plus large dans son article 2. Par exemple, il y a aussi génocide s’il y a « soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle ».
C’est exactement ce qui s’est passé au Vietnam. Le but ultime des Américains n’était pas d’effacer le peuple vietnamien de la terre, mais de le vaincre militairement quoi qu’il en coûte. L’utilisation massive du napalm et de l’agent orange (un herbicide contenant de la dioxine) entraina la mort, directe ou différée, de plus de 400.000 civils. En 1966, le tribunal Russell, présidé par Jean-Paul Sartre, se posa la question : « Le gouvernement des États-Unis est-il coupable du crime de génocide à l’égard du peuple vietnamien ? ». Il y répondit par l’affirmative et, dans le mouvement de solidarité, nous l’avions relayé.
Et c’est exactement ce qui se passe à Gaza. Le bombardement des hôpitaux et de tous les lieux de vie, le blocage de l’aide humanitaire, les coupures de l’électricité et de la distribution d’eau potable ont bien des effets sur les conditions d’existence et contribuent à la destruction à tout le moins partielle d’un peuple. Pourtant, le but ultime d’Israël n’est pas d’effacer le peuple palestinien de la terre, mais de parachever la Nakba en poursuivant son expulsion hors de l’espace compris entre la mer et le Jourdain, quoi qu’il en coûte. Si l’Égypte avait ouvert sa frontière, il n’eut pas été nécessaire d’aller jusque là. Mais elle est restée fermée. À moins d’une déportation de masse dont les conditions politiques n’existent toujours pas, le génocide rampant s’est imposé comme la seule forme possible du nettoyage ethnique.
Il m’a fallu du temps pour accepter de caractériser le carnage de Gaza comme un génocide. Je restais prisonnier de ce syllogisme : Auschwitz est l’étalon du génocide ; or, Gaza n’est pas Auschwitz, donc Gaza n’est pas un génocide. La lecture de l’impressionnant rapport d’Amnesty International m’a fait prendre conscience que la notion juridique de génocide ne se limitait pas au « modèle Auschwitz ».
Mais il y a d’autres raisons pour mon retard à l’allumage. La qualification de génocide des actions commises par Israël remonte au moins à l’opération « Plomb durci » (2008-2009), la première d’une longue série contre la population de Gaza. Celle-ci fit 1735 morts répertoriés. Les opérations suivantes (2012, 177 morts ; 2014, 2251 morts, 2018-2019, 235 morts) ne firent pas exploser ce chiffre qui, lui-même, ne dépassait pas le bilan de très nombreux conflits qui ensanglantaient alors la planète. Pourquoi la qualification de génocide émergea-t-elle dans cette circonstance et pas ailleurs ? Pourquoi vit-on alors défiler des pancartes suggérant une ’équivalence entre l’étoile de David et la croix gammée, équivalence qui évoquait bien le « modèle Auschwitz » de génocide ? Parce que toute la propagande israélienne s’inscrivait dans cette narration. Pour se rendre intouchable, Israël s’était érigé en héritier moral des morts du judéocide dont les auteurs incarnaient le mal absolu et dont il combattait les héritiers. « Plus jamais ça ! », avait-on dit à la Libération. Traduction pour Tel-Aviv : « Plus jamais “les Juifs” ne se laisseront faire », au nom de quoi Israël pouvait tout se permettre, tandis que ceux qui s’opposaient à lui n’étaient que des nazis en keffieh [1]. Retourner contre Israël l’accusation de génocide, c’était de bonne guerre. Mais, sur le fond, ce n’était pas correct.
Focalisation sur un mot
J’en étais resté là quand, après le 7 octobre 2023, ont recommencé les frappes sur Gaza. À un certain moment, les proportions ont dépassé tout ce qu’on avait connu auparavant. J’ai mis du temps à en prendre la mesure.
Pourtant, encore aujourd’hui, je regrette cette focalisation sur un mot. Je saisis bien les enjeux symboliques et c’est pourquoi je m’y suis rallié. Mais le vrai scandale, ce n’est pas que certains rechignent à utiliser un terme qui, en Europe, reste lesté du souvenir d’Auschwitz avec tout ce qu’il charrie de malentendus. Le vrai scandale, c’est que, même si on s’en tient aux qualifications établies par le droit international de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de simple risque de génocide, la communauté internationale ne lève pas le petit doigt pour y mettre fin. Le vrai scandale, c’est qu’Israël continue à bénéficier, de la part de nos États, d’une mansuétude qui vaut complicité dans le crime.
Henri Goldman,
pour.press
Note
[1] Pour illustrer cette thèse, Netanyahou révéla en 2015, en provoquant l’hilarité de tous les historiens, que c’est le Grand Mufti de Jérusalem – donc un Palestinien – qui souffla à Hitler l’idée de la Solution finale.
