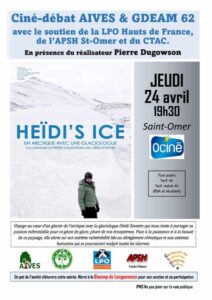
L’urgence d’un vrai débat citoyen
Forage profond à Soufflenheim, opposition unanime des élu·es, critiques sévères de la MRAE : le projet de Lithium de France cristallise les tensions. Cet article décrypte ses risques, ses logiques industrielles, les alternatives au lithium…
Soufflenheim : un projet de forage sous haute tension
Le projet déposé à Soufflenheim par Lithium de France vise à réaliser un forage exploratoire à 3 000 mètres de profondeur, afin d’évaluer la teneur en lithium des saumures géothermales du fossé rhénan. S’il ne constitue pas encore une exploitation industrielle, ce forage en est le premier jalon.
Situé en zone sismique 3, à proximité de zones naturelles sensibles, le site suscite de nombreuses inquiétudes. L’avis rendu le 1er avril 2025 par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) est sans appel : « Le dossier présente de nombreuses lacunes : il est peu détaillé, ne justifie pas le choix du site, minimise les risques sismiques et hydrogéologiques, et ne présente pas d’étude alternative ni de caractérisation suffisante des milieux à proximité » (MRAE, 2025, p). Ou encore : « Aucun élément n’est apporté pour justifier l’urgence ou la pertinence de ce forage sur ce site précis » (ibid., p).
Le Conseil municipal de Neuhaeusel, réuni le 31 mars 2025, a d’ailleurs adopté à l’unanimité une délibération s’opposant fermement au projet, invoquant les risques pour la sécurité des habitant·es et l’absence de justification environnementale et territoriale.
Une logique industrielle européenne, pas locale
Loin d’un projet isolé, le forage de Soufflenheim s’inscrit dans une stratégie industrielle intégrée, portée par Lithium de France. À Lauterbourg, une usine de raffinage de lithium est prévue pour 2027. Dotée d’une capacité de 34 000 tonnes de concentrés par an, elle sera alimentée majoritairement par des importations venues d’Amérique du Sud.
Les volumes extraits en Alsace ne couvriront qu’une infime fraction de cette capacité. Le lithium raffiné sera ensuite exporté vers l’Asie (Chine en particulier), pour y être intégré à des batteries, avant leur réimportation en Europe.
- La chaîne logistique repose donc sur :
- des forages locaux à hauts risques (séismes, pression sur l’eau, perturbation des failles)
- une unité de raffinage chimique polluante (solvants, boues)
- l’exportation du carbonate de lithium vers la Chine
- la réimportation des batteries pour alimenter le marché européen
« Ce modèle nous laisse les risques, les nuisances, les boues chimiques et les friches industrielles. Il délocalise la valeur ajoutée et les emplois qualifiés. »
Une opposition locale claire et argumentée
Face à cette logique, les élu·es locaux prennent position. Neuhaeusel, Rœschwoog et la Communauté de communes du Pays Rhénan ont émis des avis défavorables argumentés. Le Conseil de Neuhaeusel a rappelé : « Compte tenu du contexte sismique local et des incertitudes entourant ce type d’exploitation, la commune considère que ces projets présentent des risques inacceptables pour la sécurité des habitant·es et l’intégrité du territoire. »
La DREAL Grand Est reconnaît, quand-à-elle, lors d’échanges avec des collectifs et associations locales, que les projets de géothermie profonde dans le Nord du Bas-Rhin s’inscrivent dans une logique de densification progressive. Certains visent à exploiter des réseaux de failles déjà sollicités ou prévus pour d’autres opérations, ce qui suppose une interdépendance technique entre plusieurs projets en cours ou à venir. Les services de l’État admettent que les demandes de travaux doivent intégrer les effets conjugués avec d’autres projets « connus ».
Cette reconnaissance implicite d’une stratégie industrielle coordonnée éclaire d’un jour nouveau l’architecture du projet. Le forage exploratoire de Soufflenheim, les projets de Hatten ou Rittershoffen, et l’usine de raffinage prévue à Lauterbourg s’appuient mutuellement : chacun rend les autres plus acceptables, plus « rentables », plus nécessaires. C’est l’ensemble du système qui se met en place sans débat public global, sans évaluation cumulative des impacts, et surtout sans vision territoriale partagée.
Par ailleurs, le flou persiste autour des interférences entre projets, parfois analysées dans des « études d’interférence » non rendues publiques dans leur intégralité, au motif de la protection du secret industriel. Les conclusions sont rendues accessibles, mais les données techniques sont considérées comme confidentielles, empêchant toute contre-expertise citoyenne. Cette opacité institutionnelle nourrit une défiance croissante, en contradiction avec les exigences démocratiques d’un débat public éclairé.
Quelles alternatives ? Les batteries sodium-ion
Alors que les limites écologiques et industrielles du lithium deviennent manifestes, des alternatives émergent. Les batteries sodium-ion suscitent un intérêt croissant : le sodium est abondant, peu coûteux, et plus équitablement réparti à l’échelle mondiale. Et ce d’autant que des percées récentes ont été faites sur le sujet :
- En 2024, des chercheurs français ont publié une batterie sodium-ion atteignant 458 Wh/kg [ACS, 2024].
- Une étude parue dans Nature Energy en janvier 2024 souligne que, pour des applications stationnaires ou de mobilité légère, le sodium-ion est techno-économiquement compétitif face au lithium [Nature Energy, 2024].
Ces avancées plaident pour une stratégie de recherche et de sobriété, plutôt qu’une relance extractiviste à marche forcée.
Bibliographie
-
MRAE. 2025. Avis de l’Autorité environnementale – Forage exploratoire à Soufflenheim. 01/04/2025. https://www.registre-dematerialise.fr/6043
-
Conseil municipal de Neuhaeusel. 2025. Délibération du 31/03/2025
-
ACS Publications. 2024. Enhanced Energy Density in Na²V²(PO´)3 Sodium-Ion Cathode Material. DOI : 10.1021/jacs.4c17713
-
Verified Market Research. 2024. Sodium-Ion Battery Market Forecast. https://www.monolithai.com/blog/sodium-ion-battery-news
-
CNRS. 2024. Batteries sodium-ion : une première mondiale. https://www.cnrs.fr/fr/actualite/batteries-sodium-ion
-
Nature Energy. 2024. Techno-economic performance of lithium-ion vs sodium-ion batteries. DOI : 10.1038/s41560-024-01701-9
HydroLooney, hydrologue militant, abonné de Mediapart
