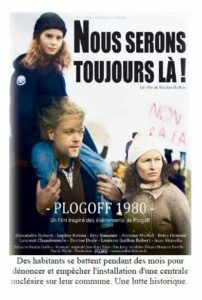Pourquoi la justice n’écoute pas la science ?
La décision de justice rendant illégales quatre mégabassines du Poitou est une victoire en demi-teinte. Les arguments portant sur la détérioration de la ressource en eau qu’elles entraînent n’ont pas été entendus.
Le 18 décembre, la cour administrative d’appel de Bordeaux a apporté une véritable « bouffée d’oxygène » aux opposants aux mégabassines. La cour a suspendu les autorisations environnementales de quatre des seize réserves de substitution du projet Sèvre-Niortaise Mignon, dans le Poitou, dont l’emblématique bassine de Sainte-Soline. Susceptibles de porter atteinte à la préservation de l’outarde canepetière, une espèce d’oiseau protégée, sans avoir obtenu de dérogation, elles ont été déclarées « illégales ».
La victoire n’est toutefois qu’en demi-teinte pour les écologistes. D’abord, parce que les autorisations des quatre mégabassines concernées ne sont que « suspendues ». « Normalement, si un projet n’est pas conforme au Code de l’environnement, il doit être annulé. Là, le juge ne fait que suspendre les projets et laisse une chance aux porteurs de projets de les régulariser. C’est sans doute influencé par le fait que les bassines sont déjà en partie construites. En réalisant leurs travaux sans respecter les règles, ils mettent la justice devant le fait accompli », regrette Marie Bomare, juriste à Nature Environnement 17, l’une des associations requérantes.
Surtout, la cour a validé les autorisations environnementales des douze autres mégabassines. Ce qui signifie qu’au-delà de la protection de l’outarde, les arguments et inquiétudes des opposants portant sur la détérioration de la ressource en eau entraînée par ces bassines n’ont pas été entendus par la justice.
Les menaces pour l’eau ignorées
Le principe de ces énormes retenues est de pomper l’eau dans le sous-sol l’hiver pour la stocker et l’utiliser pour irriguer l’été, de manière à éviter de pomper directement sur la période estivale, soumise à des sécheresses et pénuries de plus en plus intenses. Cette solution est accusée d’encourager un modèle d’agriculture surconsommant et accaparant l’eau, tandis que de nombreux scientifiques dénoncent une mauvaise maladaptation au changement climatique.
L’idée avancée par les adeptes des bassines que pomper l’eau l’hiver serait sans conséquences pour l’environnement puisqu’abondante à cette période, fait partie des points contestés. L’administration fixe des seuils : les bassines ne peuvent être remplies que lorsque les nappes ont atteint un niveau d’eau jugé suffisamment haut. Mais ces seuils sont fixés trop bas, de manière à favoriser l’irrigation, dénoncent les associations de protection de l’environnement.
« Les critères pour fixer ces seuils, la manière dont ils sont définis, sont loin d’être clairs. Il y a de grosses incertitudes d’une manière générale, y compris sur ce que serait un seuil acceptable », souligne Sylvain Kuppel, chercheur en hydrologie et membre de l’Atelier d’écologie politique de Toulouse (Atécopol).
Preuve en est : le seuil en vigueur à Mauzé-sur-le-Mignon a permis de remplir la mégabassine de Mauzé durant l’hiver 2023 alors même que la rivière était quasiment à sec. « On a même fait constater l’assec par un huissier. Mais la cour renvoie la balle à la préfecture qui devra décider si les conditions sont favorables ou non au moment du remplissage », soupire Marie Bomare.
Pas suffisant pour remettre en cause les autorisations environnementales donc, qui gèrent les seuils en question. La cour administrative d’appel de Bordeaux affirme même noir sur blanc qu’il n’existe « aucun élément au dossier » indiquant que les pompages induits par les mégabassines « empêcheraient le retour à un bon état quantitatif et qualitatif des cours d’eau ».
Interprétation controversée de la loi
Autre revers majeur pour les écologistes : la cour a confirmé la validité de l’étude d’impact, réalisée pour évaluer les conséquences sur la ressource en eau de ces projets de mégabassines. Or, cette étude d’impact avait été sévèrement critiquée pour sa non prise en compte les effets à venir du changement climatique, dans l’évaluation de la disponibilité future de l’eau sur les bassins versants concernés.
À propos de cette étude, les juges notent que « si le modèle présente des limites » et « notamment […] l’absence d’inclusion de scénarios d’impact du changement climatique », il était « au moment de l’établissement du dossier de demande d’autorisation et des porters-à-connaissance, le seul modèle existant » pertinent pour évaluer le projet.
Autrement dit, à défaut de modèle plus pertinent existant au moment de la réalisation du dossier, il est tout à fait légal, d’après la cour, de ne pas prendre en compte le changement climatique dans l’étude d’impact censée évaluer l’impact futur des mégabassines sur les ressources en eau.
L’analyse des juges pose question. L’article R122-5 du Code de l’environnement fixe les éléments qui doivent être intégrés aux études d’impact. Parmi ceux-ci, est mentionné, alinéa f, la prise en compte « des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ».
« La validation de l’étude d’impact qui ne prend pas en compte les effets du changement climatique n’est, selon moi, pas conforme au Code de l’environnement », dit Marie Bomare. Nature Environnement 17 et les autres associations requérantes n’ont pas encore décidé si elles allaient ou non contester la décision de la cour devant le Conseil d’État.
Le message des juges, qui notent que ce projet de multiples mégabassines, d’une manière générale « ne méconnaît pas le principe d’une gestion équilibrée et durable de l’eau », a de quoi interpeler. En contradiction complète avec l’analyse de nombreux scientifiques, il est également contredit par une autre décision de justice.
La justice « ne se prononce pas en fonction de la science »
Car deux batailles juridiques se livrent en parallèle sur ces mégabassines. Si la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononçait le 18 décembre sur la validité de l’autorisation environnementale, le tribunal administratif de Poitiers avait, en juillet, annulé « l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement » sur les bassins versants du marais poitevin.
En gros : la première décision concerne l’autorisation de construire les bassines, la seconde concerne l’autorisation de les remplir. Et les juges de Poitiers ont considéré que les mégabassines, dans leur version actuelle, entraînaient une hausse de la consommation totale d’eau, soit l’exact inverse de la promesse initiale.
Pourquoi, dans ce cas, la décision de justice du 18 décembre semble-t-elle à ce point trancher contre les évidences ? La réponse, pointée par Marie Bomare, tient peut-être aux contradictions internes à la législation. L’article L211-1 du Code de l’environnement est la clé de voûte du droit de l’eau en France. Or, s’il impose une « gestion équilibrée et durable » et « la protection de la ressource en eau », il appelle également à faire « la promotion d’une politique active de stockage de l’eau » afin notamment de « garantir l’irrigation ». Une disposition initialement absente du Code de l’environnement mais ajoutée par le législateur en décembre 2016.
« La loi impose un jeu d’équilibriste »
Des injonctions qui peuvent se révéler contradictoires lorsque justice doit être rendue. « La loi impose un jeu d’équilibriste et une mission impossible au juge », déplore Marie Bomare. « Les critiques de la science contre les mégabassines peuvent être aussi abondantes que l’on veut : malheureusement, la justice ne se prononce pas en fonction de la science mais en fonction de ce que le pouvoir politique met dans la loi ».
reporterre.fr
** **
Julien Le Guet RELAXÉ !
Mais le tribunal de Niort ne reconnaît pas le droit de s’exprimer librement et de dénoncer l’inacceptable !
Le collectif Bassines Non Merci se félicite de la relaxe de Julien Le Guet, co-porte parole du mouvement contre les bassines, prononcée ce jour par le tribunal correctionnel dans le cadre du procès en diffamation intenté par M. Vestieu, colonel de gendarmerie.
Pour rappel, ce procès visant Julien concernait un tag anonyme inscrit le 1er mai 2023 devant la gendarmerie de Niort, lors de la manifestation de la Journée internationale des travailleurs et dans un contexte tendu, marqué par une répression croissante du mouvement contre les mégabassines. Ce tag avait simplement rendu hommage aux blessé-es de Sainte-Soline et rappelé la réalité des violences pratiquées par les forces de l’ordre, commanditées par certaines personnalités – et dont M. Vestieu fait partie. Ce dernier avait choisi de porter plainte, espérant sans doute faire taire une critique légitime et étayée. On rappellera que M. Vestieu s’est payé cette procédure et les services de l’extrême Me Bosselut aux frais de l’Etat. Encore une dépense inutile d’argent public pour une répression à tout va.
Aujourd’hui, près de deux ans après, l’actualité nous confirme la nécessité et la légitimité de ce tag, qui appelle à ce que des poursuites pénales soient engagées contre les responsables des mutilations de nos camarades :
– le Procureur du tribunal de Rennes, qui était chargé de l’enquête sur ces responsabilités pénales, a été muté il y a un an et nous n’avons toujours aucune nouvelle des plaintes et expertises lancées il y a 2 ans ;
– la situation de Rémi Fraisse est un précédent dont on doit tirer des enseignements : après les non-lieu systématiquement prononcés par les juridictions françaises, la CEDH a condamné la France pour atteinte aux droits à la vie !
Aujourd’hui, la décision du tribunal vient affirmer que l’infraction est caractérisée mais que les pièces du dossier ne permettaient pas d’imputer l’infraction à Julien.
Qu’en est-il de la liberté d’expression ? De la légitimité de demander à ce que des poursuites pénales soient engagées, à ce que les responsables de ce « maintien de l’ordre » désastreux le 25 mars 2023 soient confondus ? À Niort, visiblement, cela ne compte pas !
Ce jugement est évidemment une victoire, mais il laisse un goût amer, tant il semble faire abstraction des droits fondamentaux. À croire qu’une loi spéciale rendant ces droits inapplicables dans les Deux-Sèvres nous aurait échappé…
Pour nous, il est clair que s’exprimer librement et dénoncer les dérives autoritaires et la responsabilité de certaines personnalités sur la politique de maintien de l’ordre dans un conflit sur un enjeu aussi crucial qu’est l’eau n’a rien d’un délit et ne devrait même pas être poursuivi. C’est au contraire l’essence même de la démocratie à travers le respect des libertés fondamentales permettant ainsi le débat public.
Nous remercions toutes les personnes, collectifs, syndicats, citoyen·nes, élu·es, avocat·es et particulièrement les témoins (la maman de Serge, Lisa Bellucco, un observateur des libertés et violences policières) qui ont apporté leur soutien à Julien et au combat collectif que nous portons ensemble.
Notre mobilisation ne faiblira pas. Le combat continue. L’eau est un commun, les libertés d’expression et de manifestation sont un droit et nous continuerons à les défendre, partout, avec conviction, détermination et solidarité.
No Bassaran !
Notre communiqué est à retrouver sur 👉
https://www.bassinesnonmerci.fr/wp-content/upload
Le Collectif BNM 79